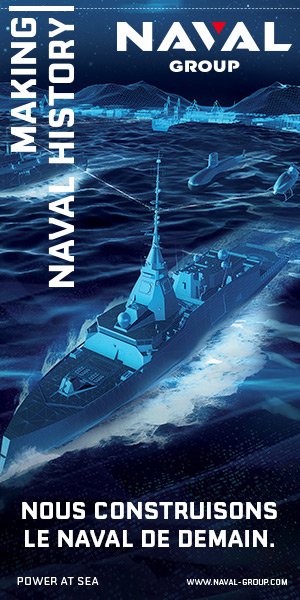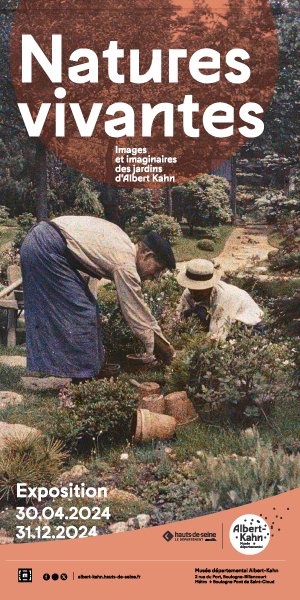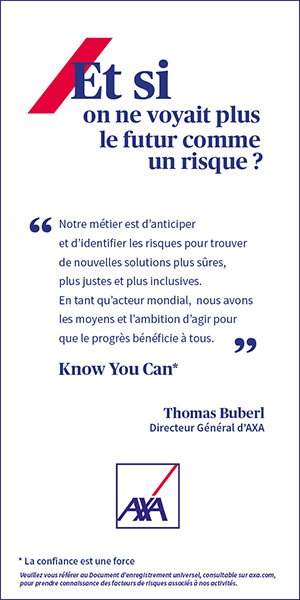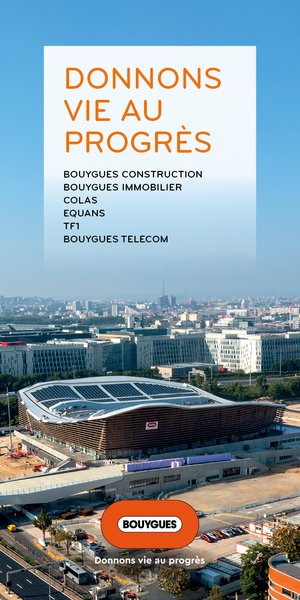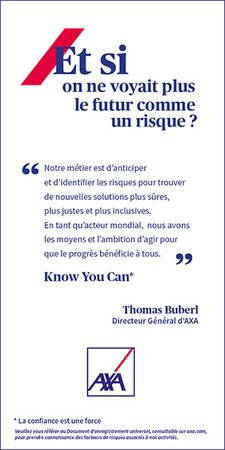Éric Danon a été ambassadeur de France en Israël de septembre 2019 à juillet 2023. Normalien, agrégé de physique, diplômé de Sciences Po Paris et ancien élève de l’ENA, ce fils d’émigrés juifs d’Égypte est souvent considéré comme un diplomate atypique, tant pour son pragmatisme dans les nombreuses négociations qu’il a menées que pour la franchise de ses analyses et sa liberté de ton. Sa carrière, menée au Quai d’Orsay mais aussi dans le secteur privé, l’a conduit à se spécialiser dans les affaires stratégiques et les questions nucléaires, la lutte contre le terrorisme et la coopération avec les pays en développement.
Désormais enseignant dans plusieurs universités et consultant international, il livre ici de façon très personnelle des réflexions sur son parcours, le bilan de sa mission en Israël ainsi que des propositions originales pour l’avenir du Proche-Orient.
M. T.
Michel Taubmann — En tant qu’enfant né à Paris de parents juifs originaires d’Alexandrie, quel rapport entreteniez-vous avec Israël et le Moyen-Orient avant votre nomination ?
Éric Danon — Je n’étais venu que quatre fois en Israël, pour de courtes missions liées à mes champs de compétences dans le domaine de la sécurité : les questions stratégiques et nucléaires, les menaces criminelles contemporaines et le terrorisme.
Je ne me connaissais aucune attache dans ce pays mais il faisait partie de mon imaginaire, comme d’ailleurs l’ensemble du Moyen-Orient. Les histoires de mon enfance évoquaient, comme un paradis perdu, l’Alexandrie cosmopolite où étaient nés mes parents au milieu des années 1920, une ville ouverte à toutes les cultures et accueillante pour les Juifs, y compris les apatrides. Le récit familial s’ancrait dans l’exil forcé de mes quatre grands-parents, juifs peu pratiquants nés à Constantinople et à Rhodes du côté de mon père, au Caire et à Beyrouth du côté de ma mère. À Alexandrie, où ils avaient tous fini par poser leurs valises, ils furent épargnés pendant la Seconde Guerre mondiale grâce au protectorat britannique. Mais quelques membres de leurs familles respectives, qui n’avaient pas émigré comme eux, disparurent dans les camps pendant la Shoah.
Mon père a quitté l’Égypte pour la France en 1946 sous une identité italienne, et ma mère en 1951 avec un passeport britannique. Le reste de la famille a été expulsé après l’expédition de Suez en 1956. L’antisionisme de Nasser avait rendu l’atmosphère irrespirable pour la communauté juive égyptienne, pourtant ancienne et bien intégrée dans le pays.
Une fois arrivés à Paris, où je suis né en 1957, mes parents se sont fixé pour objectif essentiel la réussite de leurs deux enfants par l’école et le travail, dans cette France laïque et républicaine où nous devions tout faire pour bien nous intégrer. J’en ai conservé le sentiment d’une dette envers ce pays qui nous avait permis de devenir ce que nous étions. Mes parents durent attendre 1965 pour être naturalisés. Je n’oublierai pas leur fierté à cet instant ni ma propre joie à 18 ans lors de la confirmation de ma nationalité française.
Sans doute cette histoire familiale m’a fait ressentir comme un clin d’œil du destin quand j’ai posé le pied en Israël, tout en me donnant l’impression de « boucler la boucle » pour mon dernier poste à l’étranger comme représentant de la France.
M. T. — Vous avez été le premier ambassadeur français d’origine juive en Israël. Faut-il s’en étonner ?
É. D. — Lors de mes débuts au ministère des Affaires étrangères, en 1986, un diplomate d’expérience m’avait affirmé, comme si cela allait de soi : « Mon jeune ami, avec le nom que vous portez, vous ne serez jamais nommé en Israël. » De fait, il régnait au Quai d’Orsay cet interdit implicite, au prétexte de la « double allégeance » supposée des Juifs. Ma désignation en 2019 montre le chemin parcouru par la France à l’égard d’Israël — un pays qu’aucun …
La lecture complète des articles et entretiens nécessite d’avoir un compte sur notre site Politique Internationale...
J'ai déjà un compte
M'inscrire
Celui-ci sera votre espace privilégié où vous pourrez consulter à tout moment :
- Historiques de commandes
- Liens vers les revues, articles ou entretiens achetés
- Informations personnelles