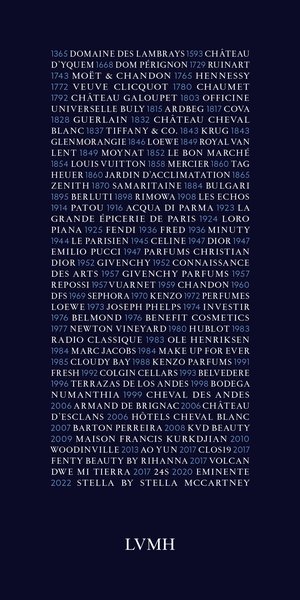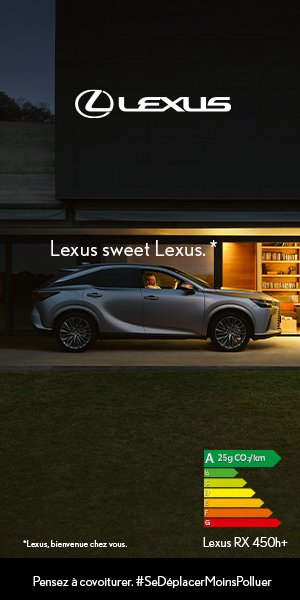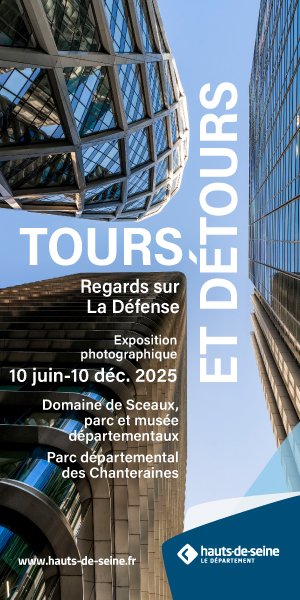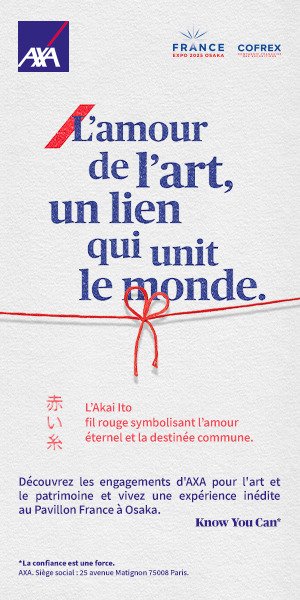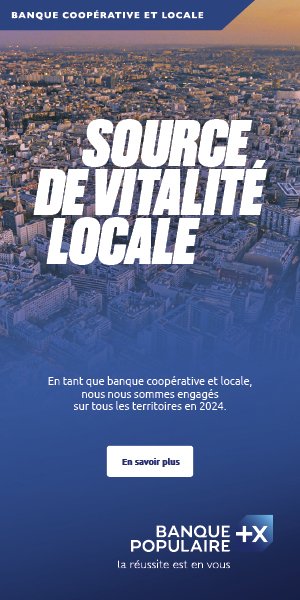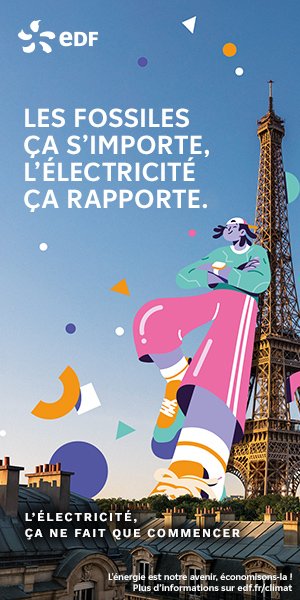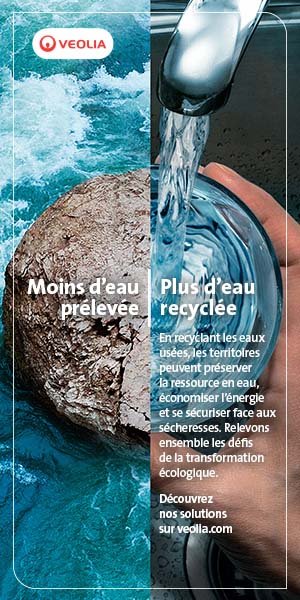Pendant huit ans, la salle de presse de la Commission européenne a brillé sous les feux des broches multicolores accrochées au revers de ses tailleurs. Arrivée de La Haye en 2004, Neelie Kroes a commencé sa carrière européenne à 63 ans à l'un des postes les plus en vue de Bruxelles : celui de commissaire à la concurrence. Mario Monti lui lègue alors deux dossiers stratégiques : Microsoft, condamné quelques mois auparavant à une amende record pour abus de position dominante, et le duopole Visa/MasterCard, dont le gendarme européen de la concurrence tente depuis des années d'essorer la rente tirée des commissions facturées aux commerçants et aux consommateurs dans les paiements par carte. Mme Kroes oblige les deux opérateurs à plafonner les commissions d'interchange, autrement dit à fixer le prix des services de paiement par carte. Cette libérale convaincue assume, au nom de la défense des consommateurs. Elle appliquera la même méthode quelques années plus tard pour venir à bout du roaming, la surfacturation des appels et du transfert de données dans les communications transfrontalières en Europe.
C'est la crise financière qui la propulse sur le devant de la scène. À partir de 2008, l'effondrement du secteur bancaire fait pleuvoir les demandes d'autorisation d'aides d'État sur Bruxelles. Au total, près de 2 000 milliards d'euros d'argent frais et de garanties publiques seront déversés sur le secteur bancaire. Les autres dossiers sont rélégués au second plan. Le gros de la tempête est passé lorsque, en 2009, La Haye demande à José Manuel Barroso, qui entame son second mandat comme président de la Commission, de maintenir Neelie Kroes dans son équipe. Elle en devient la vice-présidente en charge de l'économie numérique.
Aujourd'hui, à 74 ans, elle navigue entre le Vieux Continent et les États-Unis en tant qu'« envoyée spéciale » des Pays-Bas chargée de promouvoir son pays dans le monde des nouvelles technologies. Elle donne rendez-vous à la Stationshuiskamer, un café bruyant et branché perché au-dessus des voies de la gare centrale de La Haye, où la moyenne d'âge ne dépasse pas 35 ans. C'est là qu'elle raconte son expérience de la crise de 2008, explique comment l'économie numérique est en train de détrôner la vieille économie bancaire et pourquoi les dirigeants européens devraient apprendre à « sauter par-dessus leur ombre ».
F. A.
Florence Autret - Lorsque vous arrivez à Bruxelles en 2004 comme commissaire à la concurrence, les services de paiement figurent déjà en tête de l'agenda. Les dossiers MasterCard et Visa sont ouverts depuis plusieurs années. Comment abordez-vous le sujet ?
Neelie Kroes - Le portefeuille de la concurrence était nouveau pour moi et il est très vaste. Il ne recouvre pas que les services financiers. Des cartels de la bière aux télécoms en passant par les aides d'État, il y a de quoi faire ! La crise financière a frappé à ma porte pratiquement dès le début de mon mandat. J'avais été membre du conseil d'administration de NIB, une banque d'investissement néerlandaise. Je savais comment les banques opéraient et par quel processus minutieux les nouveaux produits étaient introduits dans le système. Mais j'avais besoin de rafraîchir mes connaissances. Donc, en arrivant, je me suis longuement entretenue avec le personnel de la Commission, avec mon cabinet et mon prédécesseur Mario Monti, non pas pour reproduire ce qu'il avait fait, mais pour comprendre la manière dont il travaillait.
F. A. - Nous reviendrons sur la crise bancaire. Dans le dossier des paiements par carte, l'Union européenne a proposé, en 2013, de réglementer les commissions d'interchange, par lesquelles les réseaux de cartes se rémunèrent. Au préalable, vous aviez décidé, dans les cas individuels dont vous aviez la responsabilité, de plafonner ces commissions. En d'autres termes, vous avez fixé les prix. C'est très inhabituel pour la Commission, et un peu inattendu de la part d'une femme politique libérale comme vous. Comment en êtes-vous venue à prendre une telle décision ?
N. K. - En tant que libérale, j'estime que, si le marché ne fonctionne pas comme il le devrait, il faut intervenir. Les gens pensent en général que les enquêtes de l'autorité européenne de la concurrence sont destinées à servir les intérêts de certaines entreprises contre d'autres (1). C'est faux. Ils protègent avant tout le consommateur. C'était très clair pour moi. Mais ce n'était pas facile, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une conviction ; vous devez, dans chaque cas, administrer des preuves. C'est d'ailleurs très bien ainsi. Chaque entreprise visée par une procédure, comme d'ailleurs tous les autres acteurs intéressés, peut saisir la Cour de justice européenne à Luxembourg pour demander qu'elle réexamine la décision. Vous devez donc être sûr de vous.
F. A. - En 2007-2008 arrive la crise financière. Des milliards d'aides publiques sont déversés sur le secteur bancaire. L'autorité européenne se retrouve sur la ligne de front. Quelle a été votre expérience sur ces dossiers bancaires ?
N. K. - Il s'est avéré que la plupart des banques ne fonctionnaient absolument pas comme on le pensait et parfois même d'une telle manière que leur comportement pouvait entraîner de graves crises. Les banques sont des animaux très différents des autres entreprises, parce qu'elles sont un rouage essentiel de l'économie et qu'elles savent parfaitement user de ce pouvoir. Elles n'ont rien en commun, par exemple, avec le secteur pharmaceutique. J'étais parfois tentée de les comparer aux grandes entreprises de télécommunication qui avaient également tendance à abuser de leur position. Mais quand je demandais à des dirigeants des télécoms, entre quatre yeux : « Êtes-vous d'accord pour dire que votre comportement n'est pas loyal ? », ils répondaient : « Oui, vous avez raison. » Alors que, dans le secteur bancaire, j'avais l'impression que toute une série d'institutions ne réalisaient pas que nous étions dans une économie très perturbée.
Tout cela va changer, du fait de l'économie numérique. J'en suis encore plus persuadée aujourd'hui. Avec les start-up, les choses bougent. Les banques ne pourront plus rester dans leur cocon.
F. A. - Voulez-vous dire que, du fait du rôle qu'elles jouent dans l'économie, les banques ont fait pression sur la Commission ?
N. K. - Exactement. À l'époque, elles pensaient que rien ne changerait. Elles voulaient continuer comme avant, parce que cela leur rapportait beaucoup d'argent. Pour être franche, il y avait un problème au sommet de nombreuses banques, mais pas seulement. Tout le système était pourri. Plus vous étiez créatif, plus vous gagniez d'argent. Dans la sphère politique également, personne n'a voulu tirer la sonnette d'alarme de peur de déchaîner des forces incontrôlables. On peut le comprendre. Mais je pense qu'en l'occurrence nous avons été trop prudents dans notre approche.
F. A. - Vous pensez aux aides publiques ?
N. K. - En tant que commissaire à la concurrence, vous devez faire attention aux conséquences de vos décisions. Je n'oublierai jamais le week-end où Northern Rock s'est effondrée. Moi-même et tous les gens de mon équipe pensions que nous pouvions circonscrire les conséquences de cette défaillance. Puis il y a eu un effet domino. Et le scénario s'est répété de proche en proche. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Il y avait un mélange d'incompréhension et de wishful thinking. Un jour, les dirigeants d'une banque qui était un peu à l'écart de cette scène de crime, sont venus me voir pour me dire que, si nous permettions à leurs concurrents de se tirer d'affaire, cela risquait de nuire à leur propre position sur le marché. Et ils avaient raison.
C'est la raison pour laquelle nous avons été très stricts dans l'autorisation des aides d'État, tout en donnant aux banques une chance de s'en sortir. Nous disions : vous devez rembourser ou alors vous devez vous séparer de certaines activités. Quelles que soient les circonstances, il est essentiel de faire comprendre au marché et aux acteurs que les mauvais comportements seront punis. Sanctionner les uns permet de limiter les dommages causés aux autres.
F. A. - Il y a eu de toute évidence des comportements fautifs. Mais, au bout du compte, les banques ont pu disposer de tout l'argent dont elles avaient besoin pour passer ce cap...
N. K. - Parce qu'elles remplissent une fonction particulière dans le système, les banques pensent qu'elles sont au-dessus des règles. Mais elles ne le sont pas. Donc, en effet, nous avons autorisé des aides d'État, mais sous certaines conditions et pour un certain temps. À partir de l'effondrement de Northern Rock, et pendant des mois et des mois, il a fallu travailler le week-end pour trouver des solutions avant l'ouverture des marchés le lundi. Il était très difficile de faire face à l'urgence. Les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne étaient de la partie. Nous avions aussi des contacts quotidiens avec les autorités américaines. Les personnes qui traitaient ces dossiers devaient être très vigilantes. Elles savaient que, si leur « client » nous attaquait devant la Cour, ce serait un désastre. C'était une période fascinante, au cours de laquelle j'ai pu apprécier la grande qualité de mes équipes.
F. A. - Avant que la crise n'éclate, vous aviez ouvert une enquête sectorielle sur les services financiers de détail. C'était la première fois que la Commission européenne utilisait cet instrument qui permet d'enquêter sur l'ensemble d'un secteur. Pourquoi l'avez-vous fait ?
N. K. - Précisément à cause de leur rôle dans l'économie et parce qu'il était difficile de comprendre comment les choses se passaient réellement. Plus tard, nous avons décidé de réglementer certains services, comme les paiements ou les cartes.
F. A. - Avez-vous été soutenue par le reste de la Commission européenne à l'époque ?
N. K. - Oui, finalement, j'ai été soutenue. Mais j'ai aussi dû me battre avec certains de mes collègues qui subissaient la pression de leur propre capitale. Les gouvernements nationaux se livraient à un lobbying intense, je peux vous le garantir, particulièrement les grands : France, Allemagne, Royaume-Uni. Pour ma part, j'étais et je suis toujours totalement indépendante. Sans cela, je n'aurais pas accepté ce poste.
F. A. - Que vous répondaient vos interlocuteurs ?
N. K. - Ils voulaient nous faire croire que la situation était sous contrôle, alors même que nous étions en pleine crise. Les banques disaient : « Vous n'avez rien à faire dans mon arrière-cour. » J'ai alors eu une série d'entretiens bilatéraux, totalement confidentiels, treize précisément, avec des dirigeants du secteur. Avec mon conseiller, un garçon très intelligent, nous leur demandions : « Pourquoi est-ce arrivé ? Et comment exactement ? Quel était votre rôle ? » Tous nous racontaient ce qu'avaient fait leurs concurrents. Et tous minimisaient leur propre rôle pour tenter de s'exonérer. Lorsque je leur demandais pourquoi ils avaient vendu tel ou tel produit et si le président de leur conseil d'administration était au courant, ils me disaient, sous le sceau de la plus stricte confidentialité : « Nous n'en avions aucune idée ! » Les produits étaient très créatifs. Le problème était qu'ils rapportaient beaucoup d'argent. Si bien que, lorsque la situation a commencé à se dégrader, il y a eu un effet boule de neige.
F. A. - Les banques centrales ont-elles joué un rôle important à l'époque ?
N. K. - Absolument. Les banques centrales nationales étaient encore chargées de la supervision bancaire. Toutes jouaient une carte très nationale. Autant vous dire que je ne me suis pas fait beaucoup d'amis !
F. A. - Quel message vous adressaient-elles ? « La stabilité financière avant tout, alors, s'il vous plaît, laissez l'argent circuler » ?
N. K. - C'est exactement cela. Je savais parfaitement ce qui se passait. C'est pourquoi j'étais convaincue que nous seuls, à la Commission, pouvions faire le travail. Au sein de la Commission, j'ai d'ailleurs beaucoup poussé pour que l'on donne plus de pouvoir à Francfort (2). Le rôle de superviseur bancaire n'est pas facile. Il faut avoir le courage de pointer du doigt les réflexes nationalistes des banques centrales. J'étais donc très favorable à la centralisation de la supervision. Personne ne pouvait accomplir cette tâche mieux que la BCE, qui était présidée à l'époque par Jean-Claude Trichet. Il s'est montré très ferme, très compétent et indépendant des forces politiques. Il était réellement au-dessus de la mêlée.
F. A. - Néanmoins, il a fallu attendre 2012 pour évoquer cette question, et 2014 pour transférer effectivement ce pouvoir à Francfort...
N. K. - Certes, mais les discussions avaient commencé pendant la crise, car nous nous étions rendu compte à quel point il était difficile de traiter ces cas. Les services financiers ont besoin de plus de transparence, les gens doivent être capables de comprendre ce à quoi ils ont donné leur accord. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous soutenons le développement du secteur FinTech (3). Certaines grandes institutions financières ont tendance à penser que rien ne changera jamais. C'est faux. Les autorités, les banques centrales et les autres acteurs financiers doivent savoir que les big players ne sont plus seuls. D'autres cherchent à gagner de l'argent sur ces marchés.
F. A. - Comment ce changement se manifeste-t-il ?
N. K. - De nouveaux systèmes de paiement, par exemple, beaucoup plus transparents, ont réussi à trouver leur place sur le marché. Tous ces nouveaux services fonctionnent avec un simple smartphone. En France, on se plaint qu'il n'y ait pas de Google européen. Mais rien n'empêchait de lancer une telle entreprise. Nous avons raté des occasions dans le passé. À présent, il faut garder l'esprit en éveil et saisir celles qui se présentent. Récemment, j'ai demandé à Tim Cook (4) : « Tim, quels nouveaux produits t'attends-tu à voir apparaître d'ici quatre ans ? » Sa réponse a été : « Mon défi est précisément de choisir la bonne idée parmi les milliers d'excellentes qui sont disponibles. » Il m'a assuré que nous utiliserions demain des objets et des services dont nous n'imaginons même pas qu'ils puissent exister un jour. Tout va extrêmement vite. Aux Pays-Bas, par exemple, MasterCard a mis en place une expérience pilote qui permet de payer avec son empreinte digitale. L'entreprise néerlandaise Adyen a, elle, créé une plate-forme qui collecte les devises et les échange instantanément. Elle travaille pour Google, Amazon et d'autres firmes, qui toutes en apprécient l'efficacité. Avec ce système, les banques ne touchent plus de commission. Sans doute paient-elles là le retard qu'elles ont pris en termes d'innovation.
Aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale. Certaines grandes entreprises sortent des schémas tout faits et s'associent à des start-up. Je me souviens du patron de Google, Larry Page, m'expliquant que, lorsque l'inventeur d'Android était venu le voir, il n'avait aucune idée de ce que cela pourrait donner. Qu'a-t-il fait ? Il a demandé de mettre à la disposition de l'équipe un étage entier et de les laisser faire ce qu'ils voulaient. C'était la bonne attitude à avoir. Il ne faut pas essayer de verrouiller les choses. Les grandes entreprises et notamment les institutions financières ne devraient pas essayer de tout faire elles-mêmes mais plutôt unir leurs forces à celles de start-up. C'est ce qui s'est passé dans l'industrie aéronautique dans les années 1970. Quelques pionniers ont relancé la construction d'avions en Europe et, aujourd'hui, Airbus supplante Boeing. Qui l'aurait cru ? Il ne faut pas s'enfermer dans la routine.
F. A. - Le secteur des high-tech est pris entre deux exigences contradictoires : le besoin de garantir la sécurité, d'un côté ; et la nécessité de créer les meilleures conditions pour l'innovation, de l'autre. Comment sortir de ce dilemme?
N. K. - La vie est pleine de dilemmes ! La réalité n'est pas noire ou blanche. Regardez les débats autour de la protection de la vie privée. Les responsables politiques doivent parfois prendre des décisions difficiles, assumer des risques. Nous avons besoin de dirigeants plus volontaristes que la plupart de ceux qui exercent aujourd'hui le pouvoir en Europe et même aux États-Unis. Les politiciens, par définition, ont une vision à court terme. Ils se focalisent sur la fin de leur mandat en se demandant comment ils pourraient être réélus.
Certes, il y a des exceptions. Je me souviens d'une conférence sur la Stratégie numérique au Danemark. Le ministre des Finances, un libéral, dépensait sans compter pour développer les technologies numériques afin de permettre aux personnes âgées qui habitent sur les nombreuses îles du pays de continuer à vivre chez elles. Il a vu une opportunité, il l'a saisie. J'ai connu pas mal de ministres des Finances, et aucun d'eux n'avait pris un tel risque. Mais lui était convaincu que c'était une réponse au défi du vieillissement et que, à terme, le Danemark allait économiser beaucoup d'argent grâce à cet investissement.
Tout est affaire de leadership, de vision et de courage. Il faut être capable de prendre des décisions déconnectées de son destin personnel. Et de se dire : « Je fais le travail. » C'est aussi simple que cela !
Les entreprises et les individus qui exploitent le potentiel des nouvelles technologies sont en train de transformer non seulement la vieille économie, en particulier les banques, mais l'ensemble de la société. Et ce n'est pas fini. Désormais, vous avez accès à toutes les informations sur votre iPhone. Vous pouvez rester en contact avec votre famille quand vous fuyez un pays et vous frayer un chemin vers un endroit sûr en évitant les dangers.
(1) Dans le cas des paiements par cartes, la grande distribution était très demandeuse d'un plafonnement des commissions.
(2) Suite à une décision des chefs d'État de la zone euro prise en juin 2012, la supervision des 130 principales banques européennes (85 % des actifs bancaires) est assurée depuis novembre 2014 par la Banque centrale européenne qui a son siège à Francfort.
(3) Jeunes entreprises qui misent sur l'utilisation des technologies numériques pour concurrencer les acteurs dominants des services financiers en général et bancaires en particulier.
(4) Directeur général d'Apple.