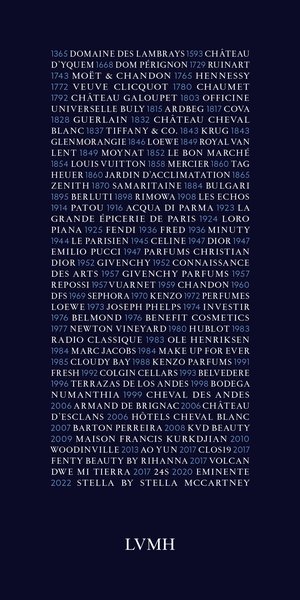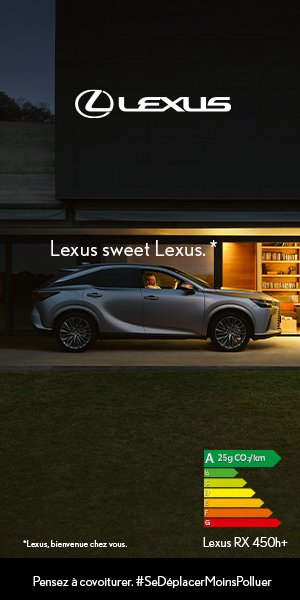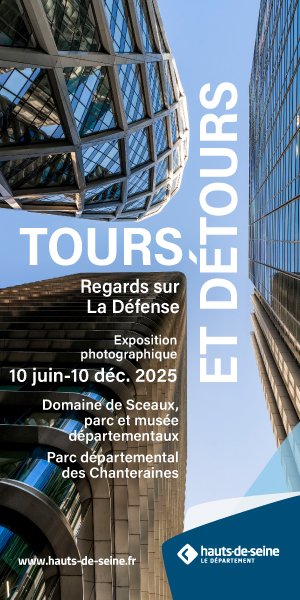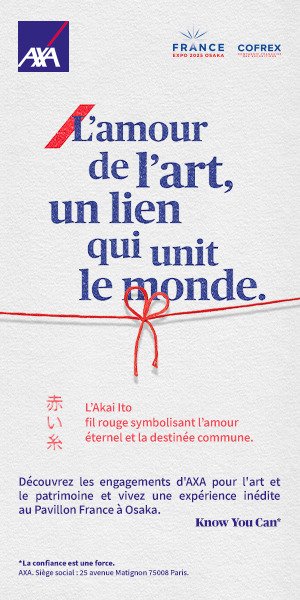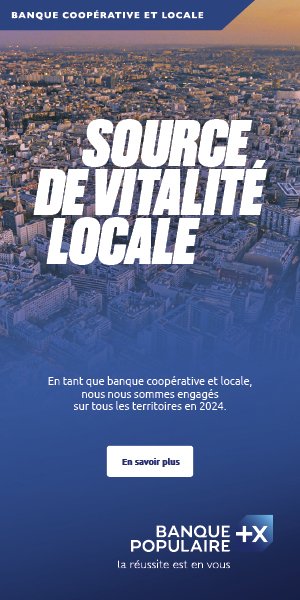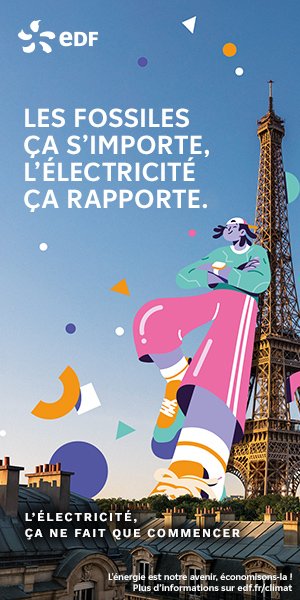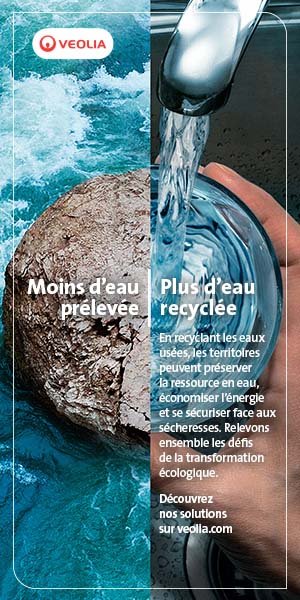Définir OuiShare, cette association présente dans 25 pays, qui observe autant qu'elle participe à l'émergence de l'économie collaborative, se révèle aussi difficile que de définir l'objet de son étude. À la fois think tank, communauté et regroupement à géométrie variable des acteurs de ce nouveau modèle économique, OuiShare constitue un poste d'observation idéal pour comprendre ce que modifient concrètement ces échanges. En termes d'emploi et de travail, quels bouleversements faut-il en attendre ? Pour le commerce lui-même - l'acte qui en constitue le sceau (le paiement) comme la convention qui en est le véhicule (la monnaie) -, l'économie collaborative (terme que notre interlocuteur préfère à celui d'économie « du partage ») change-t-elle vraiment la donne ? Pour Arthur De Grave, qui est le rédacteur en chef du magazine OuiShare (une lecture incontournable pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les Uber, Airbnb et autres circuits courts mettant en relation « petits » agriculteurs et consommateurs engagés), la réponse est oui. Mais pas comme on pourrait le penser au premier abord.
A. G.
Adrien Guilleminot - Économie collaborative : est-ce qu'on n'accole pas ici deux termes qui s'opposent ?
Arthur De Grave - L'économie collaborative, si l'on doit à tout prix la définir, qu'est-ce que c'est ? Un nouveau modèle économique, voire un nouveau type de société ? En tout cas, le terme désigne un ensemble d'activités qui « réencastrent » l'économique et le business dans le social et remettent en cause la dichotomie - qu'on avait fini par considérer comme allant de soi - entre économie et sphère sociale.
Sous le vocable d'économie collaborative on amalgame effectivement des services marchands et d'autres qui ne le sont pas. Cela dit, ce clivage n'est pas celui qui me paraît le plus important, car le marchand n'est pas nécessairement anti-social. D'ailleurs, le terme commerce a bien un double sens : il désigne l'échange d'un bien ou d'un service contre rémunération, mais aussi l'échange tout court - un être humain peut être d'un commerce agréable. Ce n'est qu'en Occident que l'économie semble aussi désincarnée et que le mercantile a acquis au fil des siècles cette connotation péjorative, voire sale. En Orient - il n'y a qu'à voir qui sont les héros des Contes des Mille et Une Nuits ! -, le marchand jouit d'une aura beaucoup plus positive. Les marchés et les souks y sont de hauts lieux de socialisation.
A. G. - Parce qu'elle permet à des particuliers de faire affaire directement entre eux, on assimile cette économie à des formules de type troc. La comparaison est-elle justifiée ?
A. D. G. - Non, pas du tout. Le troc n'a en réalité jamais été une forme dominante des échanges économiques. Pour la simple raison qu'il est très malcommode : il repose, en effet, sur la double coïncidence des désirs (un individu désire le bien que vous voulez lui échanger contre un bien que vous-même désirez). Voir dans l'économie collaborative une possibilité de remettre au goût du jour le troc constitue, à mon sens, une erreur d'appréciation. Lorsqu'on évoque la montée en puissance du troc par le biais de l'économie collaborative, on pense en réalité à tout autre chose, aux « banques du temps », par exemple. C'est-à-dire à un système d'échange de services entre particuliers, dans lequel il y a bien une monnaie (le temps), sur la valeur de laquelle on se met d'accord. Une heure de cours d'anglais vaut ainsi une demi-heure de bricolage. La même logique est à l'oeuvre dans les systèmes d'échange de maisons comme Guest to Guest : on n'y échange pas au même moment une semaine chez soi contre une semaine chez un autre membre de la plate-forme, mais en laissant son domicile à disposition quelques jours, on « gagne » une certaine durée à « dépenser » dans un autre domicile du réseau.
A. G. - Vous ne voyez donc pas de différence entre économie traditionnelle et économie collaborative ?
A. D. G. - Du point de vue de notre sujet, qui est celui du paiement, il est intéressant de noter que l'essor de l'économie collaborative a coïncidé avec une tendance de consommation beaucoup plus vaste : le développement de l'abonnement. Comparez le panier moyen d'un ménage aujourd'hui à ce qu'il était il y a vingt ou trente ans : la part de ce qui est payé non plus en une fois mais par abonnement a considérablement augmenté. Le téléphone et l'Internet, bien sûr, mais aussi la télévision (Netflix, par exemple), la musique (via les services de streaming comme Spotify ou Deezer) : on achète de plus en plus « à la découpe ». Nous avons, par conséquent, de moins en moins le sentiment de sortir le portefeuille. Nous payons sans nous en rendre compte. C'est l'un des grands enjeux des plates-formes d'économie collaborative que de rendre le paiement invisible, inodore ou, a minima, indolore.
A. G. - Pour les acteurs de l'économie collaborative, la question serait donc de « masquer » leur côté commercial ?
A. D. G. - On peut dire cela, mais il ne faudrait pas généraliser trop vite. Car au sein de ce vaste ensemble qu'est l'économie collaborative, il y a en réalité trois types de plates-formes, dont l'esprit, la façon dont elles envisagent leur rôle et in fine la manière dont elles abordent la partie commerciale de leur activité diffèrent sensiblement. Premier cas de figure, celui de plates-formes comme le site de vente par petites annonces Leboncoin : sa particularité est de faire revivre le côté sympathique, humain, du commerce de proximité. Partant de là, on comprend que la plate-forme doive se situer en retrait de l'échange lui-même, n'être finalement qu'un outil de facilitation, de mise en relation, sans aucune autre part dans la transaction elle-même. La négociation, l'interaction humaine que suppose toute vente ne concerne que les membres entre eux. Leboncoin et les autres services qui s'en rapprochent ne s'ingèrent donc pas dans le paiement des biens qui y sont échangés.
Deuxième modèle différent, celui de plates-formes comme Airbnb ou le service de covoiturage BlaBlaCar. Pour que leur système fonctionne, il doit être stable ; les utilisateurs doivent pouvoir interagir en confiance. À l'origine, le service de BlaBlaCar était gratuit, et la plate-forme ne prélevait donc pas de commission. Le paiement entre le « covoitureur » et le « covoituré » s'opérait en cash, à l'arrivée, suivant en cela l'exemple de Leboncoin. En s'interposant entre ses membres, BlaBlaCar a cherché à sécuriser le service : en clair, à réduire le taux de « no show » (la proportion de membres qui réservaient un voyage et ne se présentaient pas, sans prévenir) et à faciliter ainsi les échanges. La plate-forme s'est posée en garant du service, en tiers de confiance. Elle prend sur soi le « fardeau » de la dimension mercantile de la relation et préserve l'illusion que le service lui-même (un individu en transporte d'autres d'un point A à un point B) échappe au commerce.
Le troisième modèle, c'est celui du célèbre Uber qui, lui, assume parfaitement l'aspect commercial de sa prestation. L'ambition de l'entreprise américaine ? Créer un service « parfait », sans friction aucune, à tel point que l'utilisateur ne pense même plus à l'étape du paiement. L'horizon d'Uber, c'est donc d'éliminer toute source d'imperfection. Or la source majeure d'imperfection, c'est l'humain, le chauffeur... C'est pour cette raison, entre autres, que lorsque vous êtes véhiculé par la start-up, c'est vous qui décidez par exemple de la musique diffusée dans la voiture.
A. G. - Il y a une deuxième forme de paiement à l'oeuvre sur ces plates-formes...
A. D. G. - Effectivement, la question du paiement dans l'économie collaborative ne s'arrête pas au règlement de la prestation. Presque toutes les plates-formes reposent ainsi sur un système de notation des membres les uns par les autres (souvent au moyen d'étoiles) : c'est une forme de paiement, non monétaire. En accordant une bonne note au membre avec qui vous avez fait affaire, vous le rémunérez en réputation, en « capital social ». Et donc en transactions futures qu'il pourra conclure par la suite sur la plate-forme.
C'est aussi un système très subtil, car y entrent toutes sortes de considérations sociales liées au fait que vous allez noter un autre particulier, votre égal en un sens. La démarche se rapproche du pourboire que l'on laisse au café ou au restaurant. Une forme de contrôle social s'exerce ici : j'ai l'intuition que les notes données par les utilisateurs vont se concentrer plutôt sur les très bonnes ou les très mauvaises appréciations. Parce que, si l'expérience est globalement satisfaisante, on note comme on aimerait soi-même être noté. Mais que, si elle ne l'est pas, on va chercher par cette note à faire exclure le responsable.
A. G. - Peut-on dire, finalement, que cette nouvelle économie a suscité la création de nouvelles monnaies ?
A. D. G. - Historiquement, la création de monnaie a été un privilège royal, puis étatique. Ces systèmes de notation sont intéressants car ils trahissent une évolution en cours dans le numérique : toutes ces plates-formes d'économie collaborative se comportent, de plus en plus, comme autant de mini-États. Que font-elles, en effet ? Elles cherchent, comme on l'a montré précédemment, à assurer la sécurité des échanges entre leurs membres, mais aussi à les assurer tout court : chez BlaBlaCar, la plate-forme a souscrit pour le compte de ses membres un contrat d'assurance pour les couvrir lors des déplacements. Elle lève d'une certaine manière un impôt en prélevant une commission, dont le but est ni plus ni moins que d'assurer la pérennité du service. Enfin, elle fait la « police » parmi ses membres, les plus mal notés ou ceux qui sont signalés comme indélicats courant le risque d'être exclus.