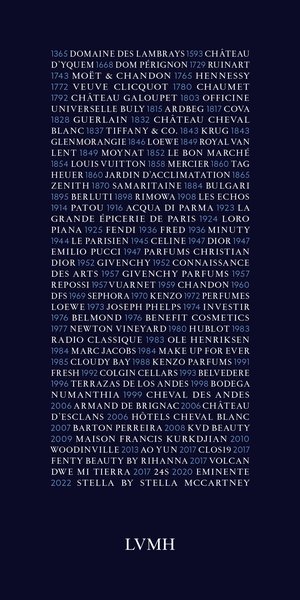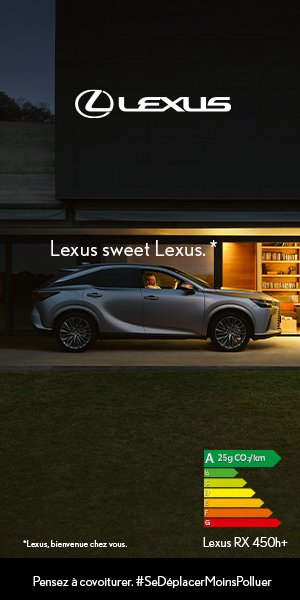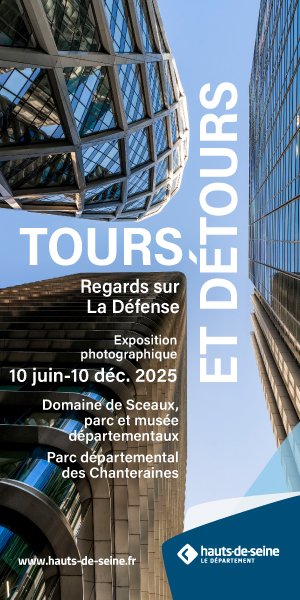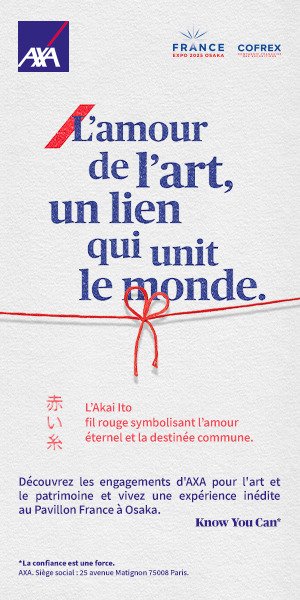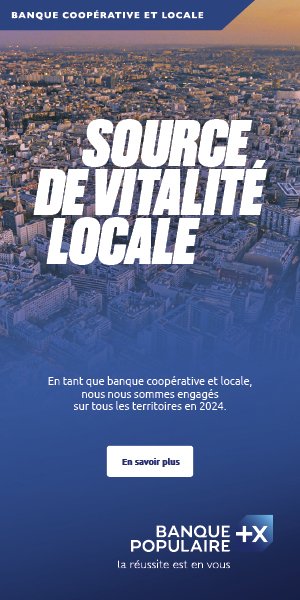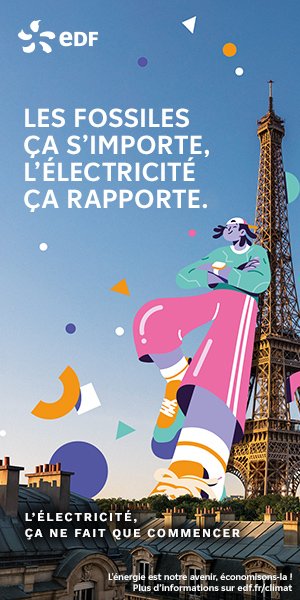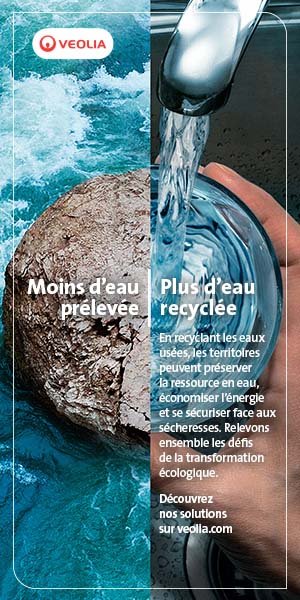La question des espèces est, en général, abordée sous deux angles : leur (inéluctable ?) disparition ; ou leur lien (exclusif ?) avec l'économie souterraine. Dans les deux cas, la réponse est contenue dans la question. Et cette réponse est sous-tendue par une vision du progrès qui ne tient compte ni des complexités ni des bégaiements de l'Histoire. Or l'Histoire n'est jamais écrite à l'avance, et le propre des téléologies est qu'elles éclairent plus sur les conditions présentes de leur formulation que sur l'avenir. Surtout, à trop se focaliser sur ces deux approches, on risque d'oublier ce qu'elles laissent dans l'ombre : non seulement leurs propres présupposés, mais aussi l'épaisseur du social qui a « sécrété » les espèces et leurs usages.
La disparition des espèces est-elle inéluctable ? Une histoire régressive
L'historien et économiste américain Bruce Bartlett le constate avec une pointe d'ironie : « Il y a deux choses que j'ai entendues tout au long de ma vie, qui ont toujours paru proches mais qui ne sont jamais advenues, c'est que nous allions vers des bureaux sans papiers et vers une société sans espèces » (1). La disparition des espèces fait donc partie de ces mirages, anciens, qui reculent au fur et à mesure que l'observateur s'avance. Face au succès croissant des billets de banque et des chèques au détriment des pièces d'or et d'argent, intellectuels, économistes et juristes (2) n'ont cessé de s'en inquiéter tout au long des XIXe et XXe siècles.
Le terme « espèces » désigne, depuis le XVe siècle au moins, la « monnaie métallique ayant cours légal. Espèces d'or, d'argent ; espèces monnayées, sonnantes (et trébuchantes) » (3). Les billets, eux, sont considérés non comme de la monnaie, mais comme une représentation de la monnaie (l'or et l'argent) ou une matérialisation du crédit de leur émetteur, qu'il s'agisse d'une banque, d'un État et, de plus en plus rarement, d'un particulier. La substitution entre ces deux formes monétaires pourrait donc évincer les « espèces ». C'est également ce que craint Chrétien-Deschamps, mémorialiste de la liquidation du système de Law : « Si dans le nombre de ceux qui possédaient ces biens immenses [en billets de la banque de Law] il s'en trouvait seulement dix qui pensassent à le réaliser en espèces, ils enlèveraient tout l'or et l'argent du royaume », remarque-t-il dans une de ses lettres (4).
À l'inverse, certains grands auteurs, et non des moindres, se réjouissent de l'effacement progressif des espèces. Adam Smith, dès 1776, considère qu'une circulation monétaire reposant exclusivement sur l'or et l'argent représente un capital inutilement coûteux, et que les billets de banque, en réduisant ce coût, permettent à la nation d'améliorer son bien-être (5). Au XIXe siècle, les laudateurs des miracles du crédit prolongent ces idées, auxquelles John Hicks donne une formulation générale : « The creation of a "substitute hard money" by control over the quantity of some sort (or sorts) of money is continually defeated by human ingenuity in the invention of other sorts » (6). Mais, dans tous les cas, il importe de maintenir cette « hard money » (7), fût-ce de manière marginale, en tant qu'ancrage, référence et contrainte du reste des instruments monétaires.
L'érosion quasiment universelle du rapport entre la masse physique des espèces d'or et d'argent et leur valeur monétaire (soit le nombre d'unités de compte monétaires pour une unité de masse d'or ou d'argent) traduit une tendance continue à la baisse de la valeur métallique de la monnaie. Menée à son terme, cette « dématérialisation » aurait entraîné la disparition de ces espèces si ces dernières, sous leur forme métallique, ne s'étaient pas totalement évanouies par étapes depuis la Première Guerre mondiale. En réalité, la vraie question est : pourquoi utiliser des espèces si leur usage est si coûteux, risqué et malcommode ?
Parce que, répond Hicks, qui se situe là dans une très ancienne tradition intellectuelle clairement établie par David Hume, contrairement au crédit, la matérialité se prête au contrôle. Il y a du crédit informel ; il n'y a pas, ou peu, d'espèces informelles. Et celles qui existent se « comptent ». Les seules exceptions - souvent plus apparentes que réelles, dans la mesure où elles peuvent faire l'objet d'un suivi et d'un enregistrement tout à fait précis - sont ces « monnaies de nécessité » et autres « monnaies obsidionales » nées dans des situations de siège, de guerre ou de crise politique. Elles raréfient les formes monétaires légales et favorisent l'apparition de substituts : « monnaie de carte » du Canada français, sous de nécessité lors de la retraite française de 1814, monnaies de nécessité pendant la guerre franco-prussienne ou la Première Guerre mondiale, pour ne prendre que des exemples français. Le point commun de toutes ces monnaies, c'est qu'elles se développent uniquement quand et parce que le pouvoir légal et légitime, le pouvoir d'État, se trouve temporairement et accidentellement suspendu. En effet, si la monnaie n'est pas par nature une chose d'État, ce dernier se l'est très tôt appropriée au point d'en faire un attribut régalien.
Pourtant, il existe une forme de monnaie manuelle qui n'a guère été touchée par la baisse tendancielle de son contenu métallique : les monnaies de cuivre et de bronze. Celles-ci ont la particularité d'avoir pu conserver pendant des siècles, notamment en Chine, une valeur presque constante relativement à l'étalon monétaire car, dès l'origine, il s'agissait de monnaies largement fiduciaires. En Europe, on assiste bien à une réduction progressive du poids métallique des petites monnaies de cuivre et de bronze, mais, hormis quelques cas, cette réduction est sans rapport direct avec le prix du métal. La raison en est que les monnaies de cuivre et de bronze, bien que sonnantes et trébuchantes, sont des espèces spéciales : elles n'incorporent pas une valeur métallique équivalente à leur valeur nominale. Aussi échappent-elles parfois au monopole public, comme en Angleterre au XVIIIe siècle où les « tokens » (jetons) pallient la pénurie de petite monnaie, ou en France dans les deux années qui suivent la Révolution, lorsque l'émission de ces petites monnaies semble devenue un métier « libre ». C'est aussi pourquoi les monnaies de cuivre et de bronze ont vu, depuis très longtemps, leur pouvoir libératoire limité à un plafond et à une proportion du paiement.
Dès lors, l'essor de formes monétaires parallèles ou dérivées - lettres de change, dépôts bancaires, billets, petites monnaies, etc. - doit aussi être vu comme une ingénieuse concurrence au monopole monétaire de l'État, lequel s'est constamment efforcé de ramener ce pouvoir monétaire sous son aile. L'extension progressive du monopole monétaire étatique aux billets de banque puis à la « monnaie centrale » que constituent les dépôts des banques commerciales auprès des banques centrales s'inscrit dans ce processus. En acceptant la dématérialisation et en étendant son monopole, l'État a pu s'affranchir de la contrainte que représentait le caractère matériel des espèces tout en maintenant cette contrainte pour les autres acteurs de l'économie.
Quand on veut noyer son chien... Les qualités du cash
Les espèces au sens strict ont donc disparu depuis longtemps (depuis la Première Guerre mondiale en France), mais elles ont vu leur fonction principale, celle d'ancrage monétaire, incorporée dans d'autres outils qui forment ensemble les instruments de la politique monétaire. La seconde dimension clé des espèces - leur caractère manuel - a été transmise à des instruments comme les billets ou les petites pièces tandis que la dématérialisation suivait son cours inexorable avec les chèques, les mandats et les ordres de paiement. C'est donc par abus de langage que l'on a assimilé une partie de ces outils aux espèces, en particulier aux billets de banque. Mais pourquoi ?
La raison principale de cette assimilation entre monnaies manuelles et espèces (8) tient, en réalité, à d'autres qualités que la supposée matérialisation de la valeur que procuraient l'or et l'argent. Parmi celles-ci : le caractère libératoire du paiement en espèces ; et l'anonymat de ce même paiement. Deux caractéristiques trop souvent réduites à la facilité qu'elles offrent aux trafiquants de tout poil, aux dictateurs en mal d'assurance, aux prévaricateurs et autres marchands de chair humaine. Comme l'a admirablement décrit Viviana Zelizer (9) dans ce qui est devenu l'un des classiques de la sociologie, ces monnaies manuelles, parce qu'elles renferment dans une chose, inerte par elle-même, le signe de leur valeur, s'adaptent à une infinité d'usages.
On peut ainsi opposer deux types de monnaies : celles qui se prêtent au « earmarking », c'est-à-dire à une affectation précise ; et celles qui restent dominées par les logiques propres à l'émetteur. Or ce besoin social de pré-affectation d'une dépense à un objet monétaire spécifique ne disparaîtra pas en même temps que les rondelles de métal, les chèques ou les billets de banque. L'essor remarquable des « cartes cadeaux » émises par les enseignes de grande distribution, sous forme matérielle ou virtuelle, le développement de monnaies adaptées aux univers des jeux vidéo ou à certains espaces socialement définis de transactions (clubs de vacances, associations, monnaies locales et complémentaires...) témoignent de la séduction qu'exerce sur le détenteur la possibilité d'attribuer une valeur sociale et sentimentale ou d'attacher un projet à une monnaie identifiée. Ces espèces-là, qui progressent rapidement, ne sont pas près de disparaître tant elles contribuent à la dimension affective de l'acte de paiement. Elles autorisent une pré-affectation de la dépense en accord avec les buts de l'utilisateur.
Le second avantage des espèces réside dans leur capacité à nouer et à dénouer dans l'instant une obligation : le paiement en espèces légales est libératoire pour le débiteur. C'est dans ce domaine - et cela s'observe dans toutes les régions du monde, de l'Inde à l'Afrique en passant par l'Amérique du Nord et l'Europe - que la prétendue dématérialisation est le plus spectaculaire. La révolution entraînée par les smartphones en matière de paiements est récente. Et pourtant, elle bouleverse déjà les habitudes quotidiennes, qu'il s'agisse des petits paiements pour les particuliers, de la gestion des fonds de caisse ou du rendu de la monnaie pour les commerçants, réduisant ainsi l'enjeu du sous-équipement bancaire dans les pays en développement. Le problème posé ici est donc celui du cash. Mais, à la différence des formes traditionnelles de cash, les « espèces électroniques » - ce porte-monnaie virtuel que l'on peut recharger ou dont on peut disposer sur une carte de paiement ou un téléphone - ne protègent plus vraiment l'anonymat.
Pourtant, là aussi, la situation est plus nuancée qu'il n'y paraît. D'abord, de quel anonymat s'agit-il ? Toute transaction monétaire implique au moins trois parties : le débiteur, le créancier, l'émetteur - et, dans l'hypothèse où l'émetteur et le débiteur se confondent, un tiers garant. La demande d'anonymat peut être formulée à l'égard d'une seule ou des deux autres parties par le débiteur ou par le créancier. Rien n'empêche donc, en pratique - c'est d'ailleurs le cas avec le paiement RFID des petites sommes par carte bancaire -, que la discrétion soit garantie à l'égard du créancier (le commerçant) mais pas de l'émetteur (bancaire de la carte). C'est à cette aune qu'il faut évaluer les formes d'anonymat permises par les monnaies cryptées dont la plus connue est le Bitcoin. Ces monnaies visent précisément à assurer un anonymat vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire l'État, le pouvoir monétaire régalien. Fort logiquement, le Bitcoin échappe de ce fait aux formes usuelles d'émission et de circulation monétaires : il applique le programme de Hicks, avec beaucoup d'« ingenuity ». À ce titre, le Bitcoin est un authentique cash - des espèces sans matérialité ! En sens inverse, l'anonymat de l'objet est parfois illusoire : comme dans The Jungle, le roman d'Upton Sinclair, où le héros découvre que, dans la main d'un pauvre, un billet de 100 dollars n'a pas plus de quelques cents de pouvoir libératoire, qu'il s'agit d'une certaine manière d'une valeur usurpée...
Dans nos pays, en France notamment, ce n'est pas la disparition des espèces qui menace l'anonymat. C'est, au contraire la réduction légale de la possibilité d'anonymat dans les transactions qui chasse les espèces. Deux phénomènes l'expliquent. En premier lieu, l'inflation a peu à peu affaibli le pouvoir d'achat des monnaies manuelles. Que l'on songe que le plus petit billet de la Banque de France en 1820 - 500 francs - représentait plus de six mois de salaire d'un ouvrier ! Et que la pièce d'or de 20 francs, qui devint l'axe de notre système monétaire au cours des années 1850, équivalait à une semaine de travail qualifié ! Traduites en valeurs actuelles, ces sommes correspondraient à un billet de banque de 7 500 euros et à une pièce de 300 euros. Avec des coupures d'une valeur maximale de 500 euros et des pièces qui ne dépassent pas 2 euros, on conçoit que la palette des paiements manuels s'est considérablement rétrécie. À ce premier phénomène s'en est ajouté un second : pour des raisons qui tiennent autant à la répression des transactions illégales qu'à la protection des consommateurs ou au fétichisme monétaire (10), la variété et le plafond maximal des paiements en liquide ont été progressivement abaissés : 300 euros pour les impôts, par exemple, et 1 000 euros de manière générale depuis le 1er septembre 2015.
Que conclure au terme de ce trop rapide tour d'horizon ? D'abord, que le terme d'espèces est contingent : chaque époque invente ses propres instruments monétaires ou, tout au moins, sa façon de les utiliser. Ensuite, que la disparition des espèces anciennes dégage l'espace nécessaire au déploiement d'espèces nouvelles car, comme nous l'avons vu, anonymat et matérialité pèsent en réalité moins que la signification sociale dans l'usage des espèces. Enfin, que cette dématérialisation doit être sérieusement nuancée : à qui fera-t-on croire qu'un euro virtuel, dont l'existence nécessite des centaines d'ingénieurs, des milliers de kilomètres de câbles optiques ou coaxiaux et des milliards d'euros d'équipements techniques, est moins « matériel » qu'une pièce de mauvais bronze frappée par deux individus dotés d'un petit creuset, d'un marteau et d'une pince ? Sûrement pas aux commerçants qui pestent parce que leur terminal est en panne...
(1) Bruce Bartlett, « America's Most Profitable Export Is Cash », The New York Times, 9 avril 2013. Traduction de l'auteur. Espèces est rendu par cash.
(2) Voir, en particulier, André Mater, Traité juridique de la monnaie et du change, Dalloz, 1925.
(3) Trésor de la langue française informatisé. Notice consultée le 28 décembre 2015.
(4) François-Michel Chrétien-Deschamps, Lettres sur le Visa des dettes de l'État ordonné en 1721, édition établie par François Velde, Classiques Garnier, 2015, p. 14. Ces lettres sont datées par leur auteur de 1732, mais François Velde montre comment elles reprennent un texte antérieur, vers 1725, du même auteur.
(5) Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, livre II, chapitre 2, Londres, Methuen & Co, 1776, version électronique sur econlib.org consultée le 29 décembre 2015. Voir, notamment, les paragraphes 24 et 26 : « The substitution of paper in the room of gold and silver money, replaces a very expensive instrument of commerce with one much less costly, and sometimes equally convenient. »
(6) John Hicks, « Automatists, Hawtreyans, and Keynesians », Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 1, n°3, août 1969, pp. 307-317. Ma traduction : « La création d'un "substitut à la monnaie physique" par le contrôle sur une sorte (ou des sortes) de monnaie est perpétuellement vaincue par l'ingéniosité humaine appliquée à l'invention d'autres sortes de monnaies. »
(7) Le terme « hard money » découle bien entendu du caractère à la fois métallique (dur) et précieux des étalons monétaires au XIXe siècle, mais il renvoie aussi à la discipline monétaire qu'ils supposent et qui a été remplacée, au XXe siècle (en oubliant les nombreux épisodes antérieurs), par les règles de monnayage imposées aux banques de second rang par les banques centrales, seules institutions susceptibles de créer de la monnaie ad libitum.
(8) Voir, par exemple, la définition du terme « espèces » donnée par le dictionnaire Larousse, version en ligne consultée le 28 décembre 2015.
(9) Viviana Zelizer, The Social Meaning of Money, New York, BasicBooks, 1994.
(10) Les autorités monétaires sont longtemps restées persuadées que la monnaie « fiduciaire » était plus inflationniste que la monnaie « scripturale ».