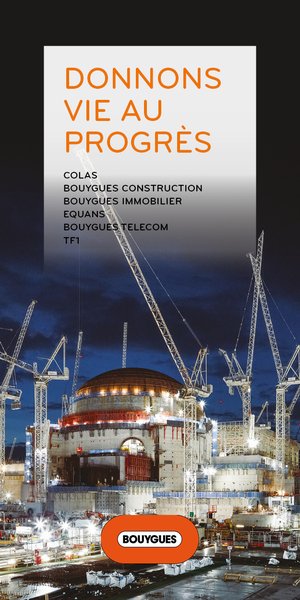Politique Internationale — Energy Observer 1 est régulièrement présenté comme le premier navire fonctionnant à l’hydrogène. Mais le projet s’inscrit en réalité dans un mix énergétique beaucoup plus large…
Victorien Erussard — Dès le début, l’idée était de concevoir un navire laboratoire. C’est ainsi qu’il a été imaginé : à bord, plusieurs énergies combinent leurs atouts au service de la transition énergétique. L’hydrogène est le principal vecteur énergétique, mais Energy Observer s’appuie également sur les technologies photovoltaïques, éoliennes et hydroliennes. Mes convictions profondes ne visent pas à opposer entre elles les différentes sources et formes de stockage d’énergie. Au contraire, elles se révèlent étroitement complémentaires. Tandis que le solaire et l’éolien contribuent à une alimentation du bateau sur le court terme — avec des batteries pour l’autoconsommation —, le stockage de l’hydrogène permet de répondre aux besoins d’énergie sur le long terme, que ce soit pour la propulsion, les contrôles commandes ou la vie à bord. Faut-il rappeler que le vent et le soleil développent des énergies par définition intermittentes, plus difficilement programmables, et que l’hydrogène constitue un moyen durable de stocker leur surplus énergétique ?
P. I. — Comment fabriquez-vous sur le bateau cet hydrogène bas carbone ? Puisqu’il s’agit d’hydrogène bas carbone…
V. E. — Le procédé est bien connu, même s’il a requis des aménagements particuliers : nous disposons à bord d’un petit électrolyseur qui permet de produire de l’hydrogène grâce à la combinaison d’eau de mer et d’électricité d’origine renouvelable.
Certes, nous sommes en présence d’une technologie complexe, mais pas non plus insaisissable, car ce procédé de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau existe aussi à terre et à différentes échelles. Ma volonté n’a jamais été de concevoir un navire qui ferait simplement rêver pour son potentiel. Nous sommes profondément ancrés dans la réalité : celle d’un bateau zéro émission directe. Preuve que ce projet n’est pas inscrit dans les limbes, le navire a déjà parcouru 50 000 milles nautiques, soit plus de 90 000 kilomètres. Nous sommes en marche, si j’ose dire, vers une technologie mature.
P. I.— Qu’est-ce qui vous a poussé, vous, Victorien Erussard, vers ce bateau d’un nouveau type ?
V. E. — Je suis breton, originaire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). J’ai grandi au bord de la mer et j’ai développé très tôt un goût pour la voile. Enfant, j’étais fasciné par les mâts géants de la Route du Rhum, ceux des bateaux de la course transatlantique au départ de Saint-Malo. Une passion qui m’a orienté à la fois vers la compétition — je suis monté sur le podium de la Route du Rhum en 2006 — et un métier, puisque j’ai une formation d’officier polyvalent de marine marchande. À ce titre, j’ai commencé par naviguer sur un paquebot de croisière, qui m’a conduit vers l’Amérique du Sud, le détroit de Magellan ou encore la péninsule Arctique. Soit des endroits assez reculés, vers lesquels tous les bateaux ne se dirigent pas.
P. I. — On mesure vite votre tropisme pour la mer, mais quid des problématiques énergétiques ?
V. E. — La fréquentation régulière des milieux marins vous met en prise directe avec la diversité des écosystèmes. Elle vous incite d’autant plus à les protéger qu’ils sont souvent abîmés et en permanence malmenés. Actuellement, quelque 98 000 navires de commerce sillonnent la planète. Seule une infime minorité, moins de 500 bateaux, fonctionne avec d’autres énergies que des hydrocarbures fossiles très polluants. Pendant ma formation d’officier, il n’y avait pas d’alternative : on s’éloignait des côtes avec du diesel, histoire de chauffer les moteurs, avant d’embrayer sur du fioul une fois en haute mer. Ces méthodes, qui sont les mêmes partout pour faire fonctionner les bateaux, contribuent au réchauffement climatique et à la dégradation de l’environnement. Bref, j’ai peu à peu développé une fibre écologique. Non pas qu’elle n’existait pas avant, mais je me suis un jour dit qu’il fallait tenter de faire bouger les choses. Le projet Energy Observer s’inscrit dans cette perspective.
P. I. — La pratique de la voile en compétition ne vous suffisait pas à apporter votre obole à une fréquentation « propre » des océans…
V. E. — Précisément, un épisode qui m’est arrivé en course a réveillé un peu plus ma conscience environnementale. En 2013, lors de la Transat Jacques Vabre, je me suis retrouvé en plein milieu de l’océan, sans plus aucune source d’énergie. Mon alternateur diesel ne marchait plus. Or c’est lui qui alimente, entre autres, nos batteries, nécessaires à nos instruments de navigation. Cet incident m’a fait réfléchir quant à la possibilité de garder, quelles que soient les circonstances, une autonomie en énergie qui ne soit pas seulement dépendante du diesel. Parallèlement, la compétition, c’est bien, c’est même formidable, mais il arrive un moment où l’on a envie de décrocher. En l’occurrence, je ne voulais plus consentir autant d’efforts pour concourir et tenter d’obtenir des trophées. Energy Observer 1 m’est apparu comme un objectif beaucoup plus stimulant, pour toutes ces raisons.
P. I. — L’aventure commence en 2013. Comment abordez-vous le projet à l’époque ? Quelles sont, selon vous, les clés de sa réussite ?
V. E. — Le principe, qui n’a rien de prétentieux, consiste à vouloir s’entourer des meilleurs. Qu’il s’agisse de partenaires concepteurs, d’industriels, de financiers, d’institutionnels… Sans oublier, bien sûr, les mécènes. L’autre grand principe consiste à déverrouiller les positions. En effet, chacun se retrouve parfois un peu prisonnier de son parcours, de sa formation ou de son activité, avec des schémas de pensée parfois trop immobiles. Il faut réussir à faire sauter ces blocages. Rien n’est aussi efficace pour cela que la richesse des échanges : on démarre une réunion en ayant l’impression que tel ou tel obstacle est insurmontable et on la termine avec de véritables possibilités de surmonter ces écueils. Dans l’intervalle, les interlocuteurs en présence ont pu échanger, confronter leur savoir, allier leurs compétences… Ils ont ajouté des briques à tour de rôle et ils ont fait bouger les lignes. Être bien entouré sert à cela, à échapper aux carcans.
P. I. — Quels sont les obstacles que vous avez dû affronter ?
V. E. — L’une des principales difficultés consiste à modeler l’écosystème autour du projet. Notre démarche s’inscrivant dans un cadre innovant, il manque un certain nombre de repères destinés à la baliser. Ce sont toutes les questions de réglementation et de certification, sur lesquelles travaille par exemple l’organisme de certification Bureau Veritas. Il peut s’agir des normes de stockage de l’hydrogène embarqué ou de quantités, de pression…
P. I. — Si l’on parle d’Energy Observer 1, c’est qu’il y a un Energy Observer 2 en préparation…
V. E. — Les deux projets sont mus par la même logique — faire fonctionner un bateau avec de l’hydrogène bas carbone —, mais la comparaison s’arrête là. Energy Observer 1 est un navire laboratoire quand Energy Observer 2 sera un démonstrateur pouvant transporter des milliers de tonnes de marchandises. Le premier a démontré l’efficacité de l’hydrogène pour naviguer autour du monde, le second entend démontrer que l’hydrogène peut être utilisé dans le transport maritime industriel. En même temps, cela signifie une puissance de propulsion électrique beaucoup plus forte, de 4 MW contre 80 kW pour son prédécesseur. La construction de ce deuxième bateau doit démarrer en 2023 pour une mise en service en 2025. Les étapes de fabrication s’annoncent différentes car il est prévu qu’Energy Observer 2 fonctionne avec de l’hydrogène liquide, et non plus gazeux. L’explication est simple : les besoins en énergie de ce nouveau bateau sont trop importants pour faire appel à de l’hydrogène gazeux, qui occuperait beaucoup trop de place. L’hydrogène liquide demande 4,3 fois plus de volume que le diesel, tandis que l’hydrogène gazeux à 700 bars nécessite 7,5 fois plus d’espace.
P. I. — Parmi vos partenaires, il y a le groupe Air Liquide…
V. E. — Air Liquide est un partenaire de référence depuis le début de l’aventure. On peut même dire qu’il a contribué à l’émergence du projet Energy Observer. Avant de songer à l’hydrogène, j’avais commencé par réfléchir à un bateau à propulsion électrique avec stockage batteries. Avant de me rendre compte que l’objectif en termes d’autonomie était inatteignable pour une navigation hauturière. Puis j’ai commencé à me documenter sur l’hydrogène. Et si vous faites ce travail, vous vous rendez compte que le nom d’Air Liquide surgit instantanément compte tenu de ses développements dans le domaine. Je me suis ainsi rapproché de l’entreprise et nous avons jeté les bases d’une collaboration pour Energy Observer 1. Avec Energy Observer 2, notre partenariat passe à un stade supérieur. Le projet s’inscrit dans une perspective industrielle de grande ampleur, avec l’idée de révolutionner une part importante du commerce maritime. Rendez-vous compte : si un tiers de la flotte mondiale passe à l’hydrogène, l’impact climatique sera important. Mais rien de cela n’est possible sans l’expertise et l’appui des industriels. Passer de l’hydrogène gazeux à l’hydrogène liquide nous fait changer de dimension, en termes de taille des équipements, de volumes traités, de quantités de production d’énergie… Pour toutes ces thématiques et beaucoup d’autres, Air Liquide est le groupe dont Energy Observer a besoin.
P. I. — Les pouvoirs publics sont-ils réceptifs à votre démarche ?
V. E. — Depuis le début du projet, j’ai multiplié les conférences auprès des institutions. On sent une grande appétence pour ce sujet qui était encore inconnu des élus voici quelques années et qui l’est de moins en moins. À l’échelle du gouvernement, les marques d’intérêt sont patentes. Energy Observer s’est vu attribuer par le ministère de la Transition le titre de premier ambassadeur des Objectifs de développement durable de l’ONU. Début février, la ville de Brest a accueilli le One Ocean Summit. Ce sommet international présidé par Emmanuel Macron, en présence de nombreux chefs d’État, a été l’occasion pour Energy Observer de présenter son nouveau défi technologique. Au cours de ces trois jours d’échanges, qui ont eu lieu avec l’appui du Cluster maritime français et du nouvel Institut pour la transition éco-énergétique maritime (T2EM), l’hydrogène a été au cœur des enjeux de la décarbonation de la filière.
P. I. — D’une manière générale, y a-t-il suffisamment de compétences pour accompagner la montée en puissance de l’hydrogène ?
V. E. — Jusqu’à une période récente, on estimait que l’hydrogène deviendrait une technologie mature vers 2050. Une échéance admise par la quasi-totalité des spécialistes dans leurs présentations. Cela, c’était avant l’accélération constatée au cours des dernières années. Aujourd’hui, les mêmes spécialistes font ostensiblement référence à 2030, date à laquelle l’hydrogène pourrait s’implanter durablement dans le mix énergétique. Parler de 2030 au lieu de 2050, ce n’est évidemment pas du tout la même chose. Toute une industrie doit se mettre en ordre de bataille et étoffer ses compétences. Cet effort démarre en amont, à travers le contenu des enseignements dans les écoles d’ingénieurs et les formations scientifiques en général, et s’inscrit dans une démarche pédagogique au sens large pour sensibiliser le maximum de gens à l’importance de l’hydrogène et à l’attrait de ses métiers.
P. I. — Quand une nouvelle énergie émerge à ce point, se pose naturellement la question de la sécurité. Est-on en mesure aujourd’hui de garantir que les processus liés à l’hydrogène ne présentent pas de risques supplémentaires pour le fonctionnement des installations industrielles ?
V. E. — Sur ce point, je peux parler de ma propre expérience. Sachez juste qu’à bord d’Energy Observer 1 ma couchette est située à moins de deux mètres des réservoirs à hydrogène. Cela donne une idée du climat de sécurité dans lequel nous évoluons. Nos ingénieurs ont plus peur des batteries que de l’hydrogène !
P. I. — Une autre question cruciale concerne le prix de l’énergie. Naviguer à l’hydrogène influe-t-il sur les coûts de transport ? On sait que, dans tous les domaines, des énergies nouvelles ont pu être retoquées parce que leur utilisation grevait la compétitivité des acteurs…
V. E. — Sur ce dossier, il est difficile de rendre des arbitrages ultra-précis. Trop souvent, on compare des données trop éloignées les unes des autres pour être vraiment significatives. Néanmoins, quelques indicateurs peuvent être mis en exergue. En particulier, la place nécessaire pour contenir les volumes d’énergie nécessaires au fonctionnement d’un bateau. Une équation veut que 1 tonne d’hydrogène correspond à l’équivalent énergétique de 3 tonnes de diesel. Un autre élément important entre en ligne de compte : dans un avenir proche, le coût des énergies fossiles et le montant de la taxe carbone ne vont cesser de grimper. Les acteurs de la logistique devront évoluer pour des raisons environnementales mais aussi économiques, tout en privilégiant l’indépendance énergétique. Mises bout à bout, ces composantes de la structure des coûts renforcent la compétitivité de l’hydrogène. Ce n’est plus une simple solution d’avenir à tester sous toutes les coutures, mais un élément de réponse face à des choix nécessaires et urgents…
P. I. — Tout ce que vous venez d’exposer fait plus que jamais d’Energy Observer un projet global…
V. E. — Comme évoqué en introduction de cet entretien, je ne défends pas une énergie plutôt qu’une autre. Les nombreux participants au projet Energy Observer prennent acte d’une planète en danger ; ils contribuent, via la mer en général et le transport maritime en particulier, à promouvoir un cercle qu’on espère voir redevenir beaucoup plus vertueux.