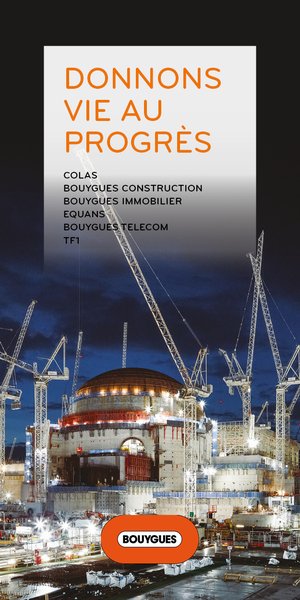Politique Internationale — L’École des Mines de Paris vient de se doter d’un Institut de la transition — The Transition Institute 1.5 (TTI.5) — que vous êtes chargée de piloter. Quelle est la philosophie de ce projet ? Qu’apporte-t-il de nouveau au débat, selon la formule consacrée ?
Nadia Maïzi — Un petit éclairage sémantique pour commencer. Derrière ce concept de transition tel que nous l’entendons au sein de l’Institut, il n’y a pas seulement la transition énergétique, qui cristallise souvent toutes les attentions. Nous parlons aussi de transition écologique, de transition technique, de transition sociale, d’externalités, de géopolitique… Toute une série de domaines qui concernent à la fois nos modes de vie et leur évolution. Bien sûr, nous ne réinventons ni ces horizons ni ces disciplines. En revanche, nous ne les abordons pas de la même manière. L’approche « en silo » qui prévaut dans la majorité des cas empêche les démarches transversales, beaucoup plus riches. Il est essentiel de décloisonner l’ensemble de ces contenus.
P. I. — Une telle approche implique des échanges accrus entre les chercheurs…
N. M. — Nous sommes tout sauf des spécialistes qui parlent aux spécialistes. Notre but n’est pas de développer un discours scientifique inaccessible au commun des mortels. Au contraire, les entreprises, les politiques ou encore les représentants de la société civile ont vocation à pouvoir s’appuyer sur les travaux de l’Institut TTI.5. Cela passe par un dialogue, où les enjeux liés à la décarbonation doivent pouvoir être clairement identifiés. Je m’adresse aux élèves des Mines de Paris, mais aussi à tous ceux qui regardent nos programmes d’un œil un peu attentif. Un étudiant ne devrait jamais être mono-sillon : selon ses appétences, il faut qu’il puisse intégrer à son cursus d’option l’étude des matériaux, les mathématiques, la sociologie… Soit un ensemble de compétences pluridisciplinaires qui lui permette d’envisager le caractère systémique de la transition qu’il faudrait déclencher. Notre institut est un encouragement au décloisonnement des formations.
P. I. — Qu’est-ce qui a motivé la création de votre Chaire sur la modélisation prospective au service du développement durable ?
N. M. — Elle a été lancée en 2008, à une époque où les travaux sur la prospective des enjeux énergie/climat à long terme étaient très peu nombreux en France. La situation a bien changé depuis : pour preuve, le nombre d’entreprises et d’organismes qui publient chaque année des scénarios de long terme sur l’état de la planète, qu’il s’agisse des émissions de gaz à effet de serre, des besoins énergétiques ou des scénarios technologiques. En 2008, nous avons en quelque sorte exercé un rôle pionnier en relançant l’approche prospective, discipline héritée des années 1950, et en déployant un important effort méthodologique. Ainsi, nous avons développé un modèle de long terme de type technologique, qui a été classé à ce titre comme laboratoire de référence pour la France par la Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP). L’exercice de la prospective de long terme nous a conduits à des réflexions quasi philosophiques alors que notre proposition d’abstraction mathématique constitue un outil qui permet de mieux appréhender une réalité forcément complexe. De manière imagée, nous considérons nos outils, dans la lignée de Gaston Berger, comme une béquille qui aide le décideur à emprunter des chemins accidentés et sinueux alors qu’il a du mal à se mouvoir. Attention, nous n’avons pas la prétention de déterminer des trajectoires prédictives pour le futur ; nous proposons des scénarios quantifiés dont l’utilité est d’éclairer les futurs possibles.
P. I. — Vous rappelez que, pendant longtemps, les travaux sur l’analyse à long terme du climat n’ont pas mobilisé les foules. Qu’est-ce qui explique cette relative indifférence ?
N. M. — Ce désintérêt s’explique tout simplement par le fait que, pendant longtemps, le climat n’a pas constitué une préoccupation majeure. Jusqu’au début des années 2000, le sujet était complètement sous les radars. Pourtant le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé dès 1988, il y a près de trente- cinq ans. À mesure que l’horizon s’assombrissait, la communauté scientifique internationale a pris conscience de l’urgence climatique et de la nécessité d’informer les décideurs. La perception de cette urgence a mis du temps à instiller. D’ailleurs, la bataille de la mobilisation est encore loin d’être gagnée : trop d’entreprises continuent à raisonner sur le court terme et à ne s’intéresser qu’au retour sur investissement et aux profits. Il faut également intensifier les efforts en direction du grand public : combien de Français connaissaient l’existence de la Conférence sur le climat avant l’organisation à Paris de la COP21 en décembre 2015 ? Il s’agissait pourtant de la 21e édition de la COP, la première s’étant tenue à Berlin en 1995. Pour ce qui nous concerne, nous participons en tant que scientifiques à ces COP depuis Nairobi (Kenya) en 2006, où a eu lieu la COP9, plus de dix ans avant la COP21…
P. I. — Vous insistez sur la nécessité d’une information objective. Le principe de neutralité est-il si difficile à tenir ?
N.M.—Tâcher de se pencher sereinement sur les questions climatiques n’est pas chose aisée. À cela une bonne raison : tout le monde a un avis sur les problématiques environnementales. La situation est propice aux thèses erronées, aux raccourcis simplificateurs ou aux risques de cacophonie. Pour éviter ces écueils, il est indispensable d’aborder ces sujets sans prismes idéologiques. Il s’agit de se dépouiller de ces multiples biais qui orientent une analyse dans un sens plutôt qu’un autre. Il s’agit aussi de faire abstraction des nombreuses contingences liées à son milieu social, son univers professionnel, son implantation géographique, ses engagements politiques… Ne croyez surtout pas qu’une personne vivant à Paris aura la même perception des enjeux climatiques qu’une autre qui habite dans le sud de la France ; et, pourtant, elles ne sont éloignées que de quelques centaines de kilomètres. Je ne dis pas que la neutralité parfaite existe, mais on peut s’en rapprocher : à charge pour les scientifiques de donner l’exemple.
P. I. — C’est d’ailleurs le rôle des Mines de Paris que de fixer un cap. Quels indicateurs mettre en exergue pour donner une idée du potentiel de l’école ?
N. M. — Les Mines de Paris ne comptent pas moins de 17 laboratoires de recherche. Ce chiffre permet de prendre la mesure de notre établissement et de sa capacité à fédérer un grand nombre de disciplines. Chaque année quelque 450 élèves sortent de leur cycle d’études avec un diplôme d’ingénieur. Auxquels il faut ajouter environ 500 doctorants inscrits, plus de 100 stagiaires en formation continue et un flux annuel d’un millier de contrats de recherche. Nos travaux de recherche sont extrêmement importants car ils alimentent en permanence le contenu de nos enseignements, dont aucun n’est une matière figée. C’est d’ailleurs l’un des aspects passionnants du métier de professeur au sein de notre École. Cet échange permanent entre recherche et enseignement est fondamental dans une période où il n’échappe à personne que les attentes des jeunes sont encore montées d’un cran : la fameuse quête de sens n’est pas un vain mot…
P. I. — Comment expliquer cette sensibilisation accrue des jeunes aux problématiques environnementales et aux mouvements de transition en général ?
N. M. — Cela fait environ dix ans que cette préoccupation grandit. Le premier facteur, c’est l’éducation : les nouvelles générations ont davantage les moyens d’appréhender les grandes mutations en cours. Elles ont les outils pour se pencher, par exemple, sur les cycles de vie et les impacts environnementaux. Ces générations montantes prennent elles-mêmes la peine de s’informer. Des figures comme Greta Thunberg sont un appui supplémentaire. Dans les écoles et les universités, les étudiants ne craignent plus de pétitionner. Ils sont capables d’afficher au grand jour leur défiance par rapport à une entreprise qui prendrait des décisions aux antipodes des exigences climatiques. Le rapport au travail aussi a profondément changé : les jeunes ne veulent plus tout sacrifier à des ambitions professionnelles. Cette recherche d’une meilleure qualité de vie et le souhait d’une amélioration de l’état de la planète sont deux puissants indicateurs.
P. I. — Pourquoi les femmes continuent-elles à être sous-représentées dans les filières scientifiques ?
N. M. — Je me souviens, au moment où j’ai fait les Mines de Paris, que nous étions 10 % de filles dans la promotion. Aujourd’hui, ce chiffre a doublé mais il reste notoirement insuffisant. On peut même dire qu’il est mauvais. Cette sous-représentation généralisée vient de loin : elle correspond malheureusement à des tendances profondes de la société. Sans même en être conscients, certains professeurs découragent les jeunes filles d’opter pour des carrières scientifiques. Ils ne sont pas aidés par les choix de certains organismes. Dans une campagne toute récente, l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP) met en exergue des garçons pour incarner les métiers de demain dès lors qu’ils ont un caractère technique. Bref, on continue à peindre l’avenir en bleu et en rose…
P. I. — Comment remédier à cette situation ? Y a-t-il des leviers sur lesquels jouer pour mieux valoriser les femmes ?
N. M. — C’est un travail de fond. On part d’une situation où, même si les femmes sont meilleures pour tel ou tel poste ou fonction, on les persuade qu’elles seront moins efficaces pour les occuper. On crée un syndrome de l’imposteur ! Les universités nord-américaines ont pris le sujet à bras-le-corps en instituant des boosters : il s’agit notamment d’améliorer la confiance en soi, les conditions du développement personnel et l’optimisation des attitudes. Quasi systématiquement, la première réaction d’une femme sollicitée pour faire une intervention ou donner une conférence sera de se demander si elle en est vraiment capable. Alors qu’un garçon, même s’il est loin de maîtriser le dossier, foncera tête baissée pour être écouté ! Par ailleurs, je crois beaucoup à l’effet d’entraînement. Dans le laboratoire de recherche que je dirige, nous sommes 80 % de femmes. A contrario, quand des femmes se retrouvent dans une réunion où 90 % de l’assistance est masculine, cela ne les incite guère à rejoindre le cercle.
P. I. — Le groupe Air Liquide est un partenaire des Mines de Paris. Quelle forme revêt cette collaboration ?
N. M. — Nous travaillons avec Air Liquide comme nous le faisons avec l’ensemble des grands groupes industriels, dont la plupart sont associés à la vie de l’école. Les contrats de salariés-doctorants sont un pivot important du système. Le dispositif est très encadré : l’octroi des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) intervient après un examen rigoureux des dossiers par un comité scientifique ad hoc. De son côté, l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) apporte les financements nécessaires. Un contrat de salarié-doctorant s’étale sur trois ans et est couronné par la rédaction d’une thèse. En général, l’étudiant répartit son temps équitablement entre son cycle d’études d’une part et sa mission dans l’entreprise d’autre part : une alternance, souvent selon un calendrier hebdomadaire, dont la richesse n’est plus à prouver. Le monde de l’enseignement et celui de l’entreprise se complètent mutuellement, avec des gains immédiatement observables. Pour revenir à votre question, Air Liquide intervient directement dans le cadre de notre mastère spécialisé Optimisation des systèmes énergétiques, avec la participation de certains de ses cadres à des conférences. Typiquement, l’hydrogène fait partie des sujets de ce mastère auxquels sont associés les représentants d’Air Liquide.
P. I. — L’hydrogène est incontestablement un dossier énergétique en plein essor. Pourquoi a-t-il surgi avec autant d’intensité, à votre avis?
N. M. — Jusqu’au début des années 2000, le sujet n’était pas encore sur la table. Ou alors de manière très parcellaire. À cette époque, je me souviens d’une publication des chercheurs d’Air Liquide qui n’envisageaient pas une montée en puissance immédiate. L’accélération s’est faite très progressivement. L’ouvrage de Jeremy Rifkin, L’Économie hydrogène (1), a marqué les esprits. Peu à peu, des projets industriels, en particulier dans le nord de la France, ont vu le jour. En Allemagne, on s’est mis à parler beaucoup d’hydrogène au lendemain de Fukushima et de la décision de sortir du nucléaire. Avec le renouvelable, l’hydrogène est présenté outre-Rhin comme la solution d’avenir pour compenser le retrait de l’atome civil et s’affranchir un jour du charbon. L’Europe est loin d’être la seule à développer des projets hydrogène. Parmi les lieux de production de l’hydrogène, notamment vert, on cite souvent le Chili et les pays du Maghreb. Mais les projets de collaboration internationale doivent s’inscrire dans une réflexion globale. C’est indispensable pour que l’industrie de l’hydrogène reste en ligne avec la lutte contre le réchauffement climatique et ne pâtisse pas de politiques énergétiques menées isolément. Cela sera d’autant plus efficace que de grands équilibres énergétiques, associant l’ensemble des continents, pourront être trouvés.
P. I. — À travers vos propos, on sent bien transparaître la différence entre des sujets fondamentaux, qui sont le socle d’une réflexion de long terme sur les enjeux énergie/climat, et des problématiques qui évoluent plutôt par vagues. Qu’est-ce qui garantit que l’hydrogène va s’imposer comme un dossier de fond ?
N. M. — L’histoire est encore loin d’être écrite. L’avenir de l’hydrogène dépend en grande partie de la capacité des industriels à lancer des projets d’envergure convaincants. Par convaincants, j’entends en phase avec les critères de réduction des gaz à effet de serre. Mais les entreprises ne sont pas les seules en première ligne : une politique énergétique se décide avec le concours de l’État, qui est chargé de donner l’impulsion aux filières émergentes, et de les inscrire dans la durée. À cet égard, la présidence Hollande a marqué un tournant en faveur de l’hydrogène, avec un volet d’aides conséquentes. Mais il reste encore beaucoup à faire pour qu’il s’impose comme une solution incontournable au service des enjeux énergie/climat.
(1) Jeremy Rifkin, L’Économie hydrogène. Après la fin du pétrole, la nouvelle révolution économique, La Découverte, 2002.