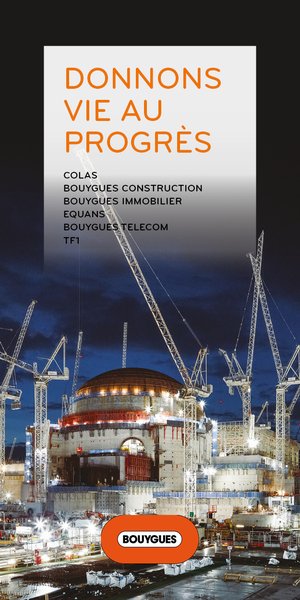Politique Internationale — La cuisine durable : le concept se répand de plus en plus et il dit bien ce qu’il veut dire. Quel est le cheminement qui conduit un chef tel que vous à adopter cette démarche ?
Alexandre Couillon — La cuisine durable, tout le monde en parle mais tout le monde en parle tellement qu’on peut légitimement se demander s’il s’agit d’une tendance de fond ou d’un simple effet de mode. En réalité, si l’on réfléchit bien, ce qui est étonnant, c’est qu’on puisse encore se demander si une cuisine est durable ou pas. Sur cette question, il ne devrait même pas y avoir débat car la cuisine, par définition, doit être durable. Je me souviens de mon grand-père : pour reprendre la terminologie utilisée à Noirmoutier, il était « marin patate ». C’est-à-dire que pendant quelques mois de l’année, de février à mai, il cultivait la pomme de terre. Puis, après la récolte, il se consacrait à son autre métier, celui de pêcheur. Bref, son activité suivait le cycle des saisons et des produits, soit des circuits courts avant l’heure mais qui s’imposaient d’autant plus que mon grand-père n’avait pas le choix : à l’époque, il n’y avait pas de moyens de transport capables d’acheminer des quantités de denrées comme aujourd’hui. Et encore moins de modes de financement qui vont avec. Pour ma part, je ne suis pas marin-patate mais avec mon épouse Céline nous avons décidé un jour de faire mieux correspondre cette activité de cuisinier avec les rythmes de la nature.
P. I. — Quelle est l’étincelle qui a déclenché chez vous le désir de changer votre manière de travailler ? Est-ce qu’on naît cuisinier durable ou est-ce qu’on le devient ?
A. C. — Davantage qu’un changement brutal, c’est le fruit d’un lent processus. Nous sommes installés ici — à l’une des extrémités de l’île de Noirmoutier — depuis vingt ans. Pendant les premières années, je peux difficilement me targuer d’avoir pratiqué une cuisine différenciante, au sens d’une harmonie spéciale avec l’environnement. Disons que je faisais un peu comme tout le monde, des fruits de mer et des moules à la crème en l’occurrence. Les choses ont changé en 1999-2000 : nous avons acheté un petit terrain pour faire des légumes. Peu de temps auparavant, j’avais pris une vraie claque lors d’un voyage au Japon : sur place, j’ai été sidéré par la fraîcheur du poisson ! Impressionné aussi par le goût des Japonais pour cette petite cuisine du marché, en lien direct avec les produits du jardin, récoltés pour être rapidement consommés. À mon retour, j’ai potassé : je me suis plongé dans les livres pour connaître les lunes, les semis ou encore tout l’agenda du maraîcher. Les lunes, c’est très important ! Vous sentez bien que cela exerce une influence sur le comportement des humains, alors pourquoi en serait-il autrement avec les légumes ou les plantes ?
P. I. — Un petit terrain pour faire des légumes, dites-vous, mais il y a quand même une différence entre cultiver un lopin de terre et ne plus travailler qu’avec les légumes de son jardin…
A. C. — Il y a eu quelques étapes entre-temps. Après ce terrain initial de 1 400 mètres carrés, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure. Soit un terrain de 4 000 mètres carrés, sur lequel veille Estelle, une personne importante au sein de l’équipe. Dans ce potager, nous cultivons 95 % des légumes qui sont servis dans les assiettes. Je ne vais pas vous dresser une liste exhaustive : carottes, navets, courges, petits pois… Nous produisons aussi une large variété de graines. Sans compter une dizaine de ruches. Le recyclage également est essentiel : la quasi-totalité de nos déchets servent à faire du compost qui, ensuite, est réinjecté dans les sols pour augmenter leur fertilité. Nous vivons en quelque sorte avec le climat. J’insiste sur cette notion car elle est source d’humilité : très tôt le matin, quand on travaille au jardin, on peut éprouver un grand bonheur devant cette richesse de produits. Mais les larmes peuvent vite arriver : il suffit d’un coup de vent pendant la nuit, ou une autre vicissitude de la météo, pour que des cultures partent en fumée. On découvre que la main de l’homme est fragile. C’est la même chose avec la mer : à Noirmoutier, nous avons deux noyaux, l’un végétal, l’autre marin. Quand les flots sont démontés, il est difficile de prévoir ce que les pêcheurs pourront rapporter. Il faut s’adapter.
P. I. — Vivre au rythme de la nature, consommer des produits de saison, ne pas brusquer les animaux ou les sols… On comprend bien ces quelques ingrédients, parmi d’autres, d’une alimentation responsable, mais quid du consommateur ? Aujourd’hui, dans les économies développées, tout le monde s’est habitué à manger ce qu’il veut à n’importe quel moment de l’année. Bref, on est aux antipodes d’un comportement écologique…
A. C. — Voilà pourquoi les cuisiniers ont, aussi, un rôle d’éducation. Nous devons faire encore plus de pédagogie. La traçabilité des produits, c’est tout sauf conceptuel. Quand je prépare un merlan avec des jeunes choux et un jus d’amande, il m’arrive de venir voir le client et de lui montrer le bateau qui, le matin même, a ramené son poisson. Je ne dis pas qu’il dégustera différemment son plat, mais son approche de l’environnement sera peut-être enrichie. À La Marine, nous avons proscrit le congélateur. Dans la même veine, les bananes, les avocats ou les fruits exotiques ne figurent pas sur la table. Nous ne sommes évidemment pas les seuls à travailler de cette façon-là : la gastronomie durable se répand de plus en plus et, avec elle, ces nombreuses initiatives écologiques qui vont parler au consommateur. Dans le mode d’alimentation actuel, on suppose chez les personnes un goût naturel pour la complexité. Or rien ne vaut la simplicité, car les gens aiment cela, profondément. J’ai des clients qui s’extasient devant une carotte : le produit est peut-être simplissime mais s’il est bon et bien préparé, que demander de plus ? N’oublions pas non plus que nous travaillons sur le registre des émotions qui, elles aussi, renvoient souvent à quelque chose de très simple. À ce sujet, puisque je parle de ma cuisine, une autre anecdote en passant : un jour, une cliente très émue éclate en sanglots après avoir mangé des langoustes servies avec des petits pois et des framboises. Céline s’inquiète auprès d’elle : y a-t-il quelque chose qui l’a brutalement chagrinée ? Pas du tout, les framboises l’avaient ramenée à un souvenir d’enfance, quand elle allait les cueillir avec son grand-père…
P. I. — Vous êtes installé à Noirmoutier en Vendée, à proximité immédiate de l’océan. Mais lorsqu’on habite à plusieurs centaines de kilomètres des côtes, peut-on se permettre, comme vous, de faire une cuisine responsable ?
A. C. — Je comprends parfaitement cette remarque. Pour autant, cela n’a pas que des avantages d’habiter à deux pas de la mer ou de son potager. Ou plus exactement, cela réclame une bonne dose de travail. Très souvent, le matin quand je me lève, je ne sais pas exactement ce que je vais préparer quelques heures plus tard. Cela dépend de l’inspiration mais cela dépend surtout, comme je l’ai déjà évoqué, du résultat de la pêche : souvent elle est bonne, parfois elle est moins bonne. Être en prise directe avec les éléments, savoir que les produits ne sont pas immédiatement disponibles sur un claquement de doigts, cela forge le caractère. Il faut apprendre à fonctionner autrement. La géographie est un élément important mais ce n’est pas non plus l’alpha et l’oméga : une cuisine respectueuse de l’environnement est parfaitement maîtrisable loin de la mer ou de la montagne. Pour preuve, les cartes aujourd’hui sont beaucoup moins fournies. Souvenez-vous, il y a vingt ans, quand vous alliez au restaurant, vous aviez le choix entre une bonne vingtaine d’entrées et autant de plats. C’était parfaitement irresponsable. Désormais, la plupart des cuisiniers savent qu’une carte réduite est un gage de qualité bien supérieur par rapport à une longue litanie de mets. Et puis il y a aussi, en plein centre-ville, les cuisiniers qui mutualisent leurs compétences. Bien sûr, ils sont concurrents mais se mettre à plusieurs pour acheter une plus grosse quantité de produits est un geste est éminemment responsable. Au Danemark, en tout cas, une telle attitude est entrée dans les mœurs des restaurateurs. Pour finir sur la géographie, les métropoles sont de moins en moins éloignées des centres de production agricole. À l’instar de ces gros maraîchers présents désormais aux portes de la région parisienne.
P. I. — À vous entendre, la cuisine durable n’est pas un luxe. Il n’empêche que pousser la porte de votre établissement représente quand même un — petit — investissement…
A. C. — La plupart des produits que je travaille ne sont pas luxueux. Parmi les poissons, la sardine, le grondin, la vieille ou le chinchard ne sont pas les espèces les plus prisées, loin s’en faut. D’ailleurs, mes amis pêcheurs continuent à s’en étonner, me rappelant par exemple que le chinchard n’est bon qu’à donner aux chats ! Enfin, pas si on l’accommode d’une certaine façon ! Ce qui est luxueux, en revanche, c’est un certain mode de travail. Mon potager de 4 000 mètres carrés ne sert pas à vendre des légumes sur le marché. Il ne permet de produire qu’en petites quantités, à destination exclusive des assiettes du restaurant. En outre, il faut un matériel un peu performant pour travailler dans de bonnes conditions. Mis bout à bout, tous ces éléments représentent un certain coût. Alors oui, plus que la cuisine durable, la gastronomie durable à un certain prix. Mais ce n’est pas non plus un plaisir que l’on s’offre tous les jours : je connais des gens modestes qui économisent un peu tous les mois pour venir à Noirmoutier. Parlons justement de plaisir : une démarche responsable ne doit surtout pas être vécue comme un exercice coercitif ; mon équipe et moi sommes là pour procurer un moment de bonheur, il ne faut jamais l’oublier.
P. I. — Dans sa spécialité, le professionnel que vous êtes a-t-il conscience de la fragilité de la planète ?
A. C. — Permettez-moi de vous raconter cette expérience : un jour, j’étais sur une plage de Noirmoutier avec ma fille Emma, alors enfant. Elle jouait dans le sable quand soudain, en creusant un peu, elle tombe sur une galette de pétrole. À l’époque, nous étions quelques années après la catastrophe de l’Erika (1) : Noirmoutier n’est pas la zone qui a été le plus touchée par l’accident mais le fait même qu’elle l’ait été montre bien l’étendue des dégâts. Imaginons un instant que l’Erika fasse naufrage aujourd’hui : eh bien, le restaurateur que je suis ne pourrait plus exercer. Comme ma cuisine est d’inspiration marine — avec le travail de nombreux poissons —, je serais totalement démuni. Mais en l’occurrence, ce n’est pas moi qui compte, ce sont les trente personnes qui sont à mes côtés (2), tous les jours, pour accueillir les clients. Bref, du jour au lendemain, une catastrophe écologique peut ruiner une affaire et décourager tout un petit groupe d’hommes et de femmes. La préservation de la planète, ce ne sont pas des grands mots ou des grands principes : c’est une manière d’agir. Sur cette plage de Noirmoutier, en voyant ma fille attraper une boulette d’hydrocarbures, j’ai pu mesurer à la fois notre fragilité et l’urgence de se prémunir contre les atteintes à l’environnement.
P. I. — Lorsqu’on parle de cuisine, on ne peut pas faire l’impasse sur les guides et leur rôle prescriptif qui ne va pas sans polémiques. Ces juges de paix — ou pas — sont-ils sensibles à l’écologie ? Par ailleurs, qu’est-ce qui vous manque encore pour obtenir une troisième étoile au Guide Michelin ? Cette quête est-elle compatible avec le maintien d’une démarche durable ?
A. C. — Oui, les guides sont devenus réceptifs à une cuisine durable. J’en veux pour preuve que le Guide Michelin a créé une catégorie spécifique pour saluer cette démarche. Cette distinction est nouvelle mais dans quelques années, elle sera entrée dans les mœurs. Alors évidemment, la troisième étoile… Je dis « évidemment » parce que cela fait partie du jeu de s’interroger sur une progression, dès lors qu’on commence à être distingué. Mais je ne suis pas non plus obsédé par les récompenses ; je ne me demande pas tous les jours quels sont les points à améliorer pour aller plus haut. Être un cuisinier engagé, présent dans sa cuisine et ancré dans son terroir : permettez-moi de dire que j’ai le sentiment de cocher ces trois cases, qui sont une bonne base de travail pour voir ses compétences reconnues. L’année dernière, la salle de La Marine a été refaite, quasi-exclusivement à partir de matériaux biosourcés, comme ces murs en carton recyclé. Il ne s’agissait pas de réaménager pour tenter de décrocher une étoile supplémentaire, mais d’abord de donner un petit coup de dynamisme au décor ambiant, avec toujours cette idée d’avancer de manière vertueuse.
P. I. — La cuisine renvoie souvent à quelque chose de très franco-français. Ce prisme un peu étroit n’est-il pas un inconvénient au moment d’envisager la préservation de la planète ?
A. C. — Je crois que chacun se construit avec ses expériences. Dans mon cas, j’ai vécu quinze ans en Afrique. Ma mère était couturière industrielle et mon père pêcheur. Celui-ci a eu l’occasion d’aller faire une campagne au large du Sénégal. Ma mère l’a rejoint et ils se sont établis à Dakar, où je suis né. Récemment, j’ai eu l’occasion de retourner en Afrique. Indépendamment des conditions de pauvreté, j’ai été surpris par la surutilisation du plastique. À Dakar en l’occurrence, quoi que vous achetiez, un petit objet ou un produit alimentaire, il est immédiatement emballé dans du plastique. Ces sacs ou ces sachets ne vont pas très loin : on les retrouve par milliers sur les plages, où ils vont polluer les sols pendant des générations. Cette vision m’incite encore plus à respecter les gestes écologiques, comme ceux que nous réservons à nos clients à Noirmoutier : le moins d’emballages possible, et s’il doit y en avoir, ces emballages doivent être fabriqués à partir de matériaux responsables. Cela aussi pour dire qu’il n’y a pas de vision spécifiquement nationale, ou spécifiquement internationale, de la préservation de la planète. Toutes les dimensions s’interpénètrent. Il m’arrive de me demander ce que j’aurais envie de faire si je devais sortir un jour de ma cuisine. L’Afrique serait une bonne destination : pour y implanter une école de formation hôtelière. Non pas qu’il n’y ait pas d’établissements, mais celui-là serait résolument tourné vers un apprentissage responsable, une utilisation respectueuse des produits et la volonté de préserver les grands équilibres naturels. Finalement, Noirmoutier n’est pas si loin de Dakar…
P. I. — À quoi ressemblera la mobilité des biens et des personnes dans un monde zéro carbone ?
A. C. — Cette mobilité est pour le moins difficile est à imaginer. Le chemin à parcourir est encore long mais cela n’empêche pas de se projeter. Si l’on commence par les biens, les circuits courts sont une piste à creuser au maximum. Faire appel aux produits locaux s’inscrit dans cette veine. Dans le secteur qui est le mien mais qui touche aussi énormément de monde, le choix des légumes et des fruits de saison, de même que le recours à la pêche durable, sont des balises importantes. Pour les personnes, la mobilité dans un monde zéro carbone implique d’être moins tributaire de sa propre voiture. Sait-on que le covoiturage a également toute sa place dans les trajets courts ? D’une manière générale, l’utilisation des transports en commun doit être largement optimisée, avec une meilleure intégration des bus et des trains dans le système actuel. Le développement des pistes cyclables s’avère aussi une nécessité. Sans oublier le fait de privilégier la marche dans les centres villes et les petits villages, qui a pour corollaire de redynamiser le commerce de proximité.
P. I. — Quel impact ces développements auront-ils sur la liberté de mouvement ?
A. C. — Toutes les démarches écologiques entraînent un changement de mode de vie. On pense alors parfois que notre liberté va en être affectée. Certes, des contraintes surgissent à l’horizon. Mais finalement, ces obstacles ne sont pas aussi sévères qu’on l’imaginait au départ. Par exemple, l’accès aux transports en commun — rendu plus facile dans un monde zéro carbone — ne nous obligera plus à être aussi dépendant de la voiture. Pour partir en vacances ou se déplacer dans un autre lieu, on prendra le bus ou le train. Tout est une question de perspectives.
Cet entretien a été réalisé en novembre 2020.
(1) L’Erika est le supertanker qui fait naufrage en 1999 au large de la Bretagne.
(2) L’entreprise d’Alexandre et Céline Couillon comprend un restaurant gastronomique, un bistrot et un hôtel.