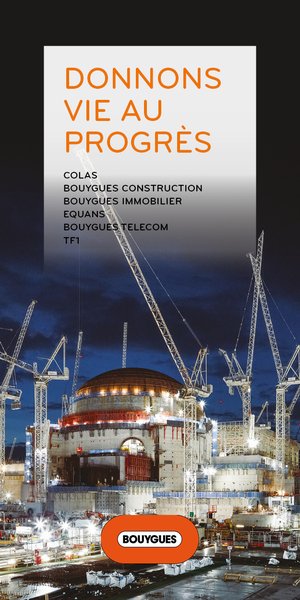Politique Internationale — La fiscalité écologique, destinée à financer la transition énergétique, ne peut-elle être que punitive ? C’est en tout cas le sentiment qu’elle donne. À votre avis, peut-elle renvoyer à d’autres horizons, plus positifs ?
Christian Gollier — La taxe carbone est considérée comme punitive au sens où elle pèse à la fois sur le pouvoir d’achat des ménages et sur les capacités d’investissement des entreprises. Cette taxe est comme toutes les taxes : elle capte une partie des revenus et, forcément, elle est mal accueillie. La crise des Gilets jaunes en France symbolise ô combien ce mécontentement. Au prix actuel de 44 euros la tonne de CO2, le litre de super se voit imposer un surcoût de douze centimes. Et cela, un grand nombre de foyers ne l’ont pas supporté. Ils l’ont d’autant moins supporté qu’ils ne peuvent pas faire autrement que de s’approvisionner régulièrement à la pompe, notamment pour aller travailler. La sévérité de cette crise, que nul ne conteste, ne doit pas nous empêcher de raisonner indépendamment du contexte économique et social. Je veux dire par là que nous devons aussi avoir à l’esprit l’urgence climatique. Qu’on le veuille ou non, le constat est là et il est sans appel : nous émettons trop de CO2, beaucoup trop de CO2. Si rien n’est fait pour enrayer cette inflation, la planète court d’immenses dangers. Disons-le sans ambages : à terme, c’est la survie même de l’espèce humaine qui est en jeu. Dans ces conditions, pour abandonner le CO2, ou en tout cas pour limiter les émissions, il n’y a pas trente-six leviers à actionner. Deux grands domaines d’activité doivent être reconsidérés en priorité : l’énergie et l’agriculture.
Le premier est, de loin, le plus important : qu’il s’agisse du charbon, du pétrole ou du gaz, les sources fossiles sont d’énormes gisements de CO2. Pour tenter de les éliminer, le renouvelable offre une alternative, mais elle se révèle coûteuse : quand le kilowattheure (KWh) fossile est produit autour de 5-6 centimes, le KWh éolien ou solaire oscille entre 10 et 25 centimes. Bref, la transition énergétique requiert des investissements conséquents, et les consommateurs vont devoir sacrifier un peu de pouvoir d’achat pour accompagner sa réalisation. Problème : les gens, dans leur écrasante majorité, ne comprennent pas — ou difficilement — qu’on leur réclame un effort, parfois substantiel, pour contribuer à la protection de la planète.
P. I. — Les ménages doivent-ils nécessairement être en première ligne pour financer cette transition vers une économie moins carbonée ? Quels autres acteurs pourraient prendre leur part ? Comment veiller à une répartition équilibrée des efforts ?
C. G. — Une tentation naturelle consiste à appeler les pouvoirs publics à l’aide. Ceux qui soutiennent cette idée disent volontiers qu’on pourrait nationaliser le secteur de l’énergie et que l’État est le mieux placé pour financer les champs d’éoliennes et les fermes solaires, surtout quand il s’agit de programmes à grande échelle. Car la taille des périmètres ne souffre pas l’imprécision : pour remplacer une centrale à charbon ou une centrale à gaz, ce ne sont pas quelques éoliennes qui font l’affaire. Non seulement il en faut plusieurs dizaines, mais on doit aussi se mettre en situation de remédier à l’intermittence des énergies renouvelables. Bref, une industrie se substitue à une autre industrie. Pour appuyer cet effort, la nationalisation est une solution à courte vue : si les pouvoirs publics assument le poids de ce financement, ils le répercuteront tôt ou tard sur les ménages avec une augmentation des impôts à la clé. Taxe carbone ou pas, il y aura toujours un alourdissement de la fiscalité qui fera descendre les gens dans la rue.
Pour mieux comprendre ces problématiques, un effort de pédagogie est nécessaire : on a beau se soucier des générations futures, lorsqu’on demande à quelqu’un de faire un effort pour ceux qui viendront après lui, il a plutôt tendance à renâcler. Voilà pourquoi la Convention citoyenne pour le climat (NDLR : lancé en 2019 avec des conclusions au printemps 2020) est une initiative intéressante. Le dossier environnemental ne doit pas rester un débat d’experts. L’échantillon de 150 personnes qui a pu auditionner une série d’acteurs (climatologues, économistes, entreprises…) couvre bien les préoccupations de la population. On peut toujours discuter des propositions, mais plus il y aura d’interactions entre les différentes strates de la société, plus la lutte contre le CO2 pourra s’enraciner dans les mentalités.
P. I. — Puisque vous parlez de pédagogie et faites référence à la crise des Gilets jaunes, l’un des reproches majeurs adressés à la taxe carbone concerne l’absence de fléchage. Est-ce si difficile d’orienter les sommes récoltées vers tel ou tel volet de la transition énergétique ?
C. G. — On touche là à l’essence de la taxe carbone et de la fiscalité écologique en général. Cette taxe n’a pas vocation à financer précisément telle ou telle opération, qu’il s’agisse de l’implantation de 150 éoliennes, d’un gain d’efficacité énergétique dans une usine ou d’un plus grand confort thermique dans un ensemble de bâtiments. Le cadre de la taxe carbone est beaucoup plus global : il s’agit de rappeler aux gens et aux entreprises que lorsqu’ils émettent du CO2 ils infligent à la planète un dommage qui doit être réparé. Le principe est celui du pollueur-payeur : vous polluez, alors vous payez pour vous forcer à tenir compte dans vos choix des dégradations que vous causez. En vous faisant payer une taxe égale au dommage, chaque individu va internaliser ce dommage comme s’il en était lui-même la victime. Cela permet d’aligner les intérêts privés avec l’intérêt général. Ce qui s’applique aux ménages est également valable pour les entreprises : dès lors que leur activité produit du CO2, des sommes dédiées doivent pouvoir contrebalancer cette atteinte à l’environnement. Entreprise ou particulier, vous êtes pollueur ? Alors vous acquittez le prix d’un dommage.
P. I. — La taxe carbone est vécue également comme quelque chose de profondément inégalitaire. Au sens où seuls les ménages les plus aisés peuvent s’offrir des solutions innovantes, basées par exemple sur les réseaux intelligents ou les sources d’énergies renouvelables. Équiper son habitation de panneaux solaires, rouler en voiture électrique ou piloter sa consommation d’énergie à distance n’est pas à la portée de toutes les bourses. A contrario, les foyers précaires restent largement tributaires des énergies traditionnelles — comme le super, le diesel ou le fioul domestique —, lourdement taxées…
C. G. — C’est un vrai sujet. Les ménages modestes subissent en quelque sorte une double peine : ils ne bénéficient pas des atouts de la transition énergétique et leur budget limité les maintient dans une dépendance au fossile. Nous sommes dans un cas de figure différent de celui de l’impôt sur le revenu où les foyers les plus fortunés se voient imposer un taux de prélèvement supérieur. Dans l’énergie, les plus pauvres sont les plus pénalisés. Faut-il accepter irrémédiablement cette situation ? Évidemment non. Mais la taxe carbone engendre un revenu fiscal que l’État peut utiliser pour compenser, voire surcompenser, les ménages les plus modestes. Un chèque vert en l’occurrence qui, dans l’idéal, ne rendrait pas seulement du pouvoir d’achat mais permettrait aussi aux foyers modestes de s’équiper de façon plus vertueuse pour l’environnement. Ce système de redistribution existe déjà, mais il doit être renforcé. Sinon, l’image de l’énergie responsable risque de rester spontanément accolée aux bobos parisiens qui n’hésitent pas à payer plus cher pour acheter de l’électricité verte.
P. I. — Vous dites que les gens ont souvent du mal à comprendre l’importance de la lutte contre le réchauffement climatique. Et que, par extension, ils n’intègrent pas la nécessité de consentir un effort financier pour préserver la planète. Qu’en est-il avec les entreprises ? Celles-ci sont-elles plus disposées à mettre la main au portefeuille ?
C. G. — Autant les gens se représentent mal l’urgence climatique, autant les entreprises savent, elles, qu’il faut agir. En tant que président de l’Association européennes des économistes de l’environnement (EAERE), je rencontre un grand nombre de dirigeants de grandes entreprises énergétiques et du monde de la finance. Ils se montrent tous convaincus de la nécessité de lutter contre les émissions de CO2 et, par conséquent, de définir des mécanismes de prix du carbone efficaces. Malgré un impact négatif sur leur marge, cette conviction s’explique assez facilement : les entreprises ont horreur de l’incertitude. Ne pas savoir comment l’État imposera les actions et les politiques nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 est une source d’angoisse pour les entreprises, leurs employés et leurs actionnaires. Annoncer une politique crédible de prix du carbone pour les trente prochaines années serait un soulagement, tout en offrant la transparence et la prévisibilité dont les entreprises ont besoin pour construire leur stratégie industrielle de long terme. Sans cela, point de transition énergétique !
Or, sur le plan industriel, les incertitudes technologiques sont notables. Qui peut dire aujourd’hui ce que sera la répartition du « mix » électrique dans dix ans ? Personne. On peut simplement échafauder des scénarios. Voilà pourquoi les entreprises aimeraient disposer de contours précis sur le marché du carbone : pour elles, ce sera une inconnue en moins. À l’Association des économistes de l’environnement, nous avons fortement appuyé une pétition qui réclame notamment pour le CO2 un signal prix très clair. Cette pétition s’inspire directement d’une initiative prise aux États-Unis par le Climate Leadership Coalition. Outre-Atlantique, de très nombreux acteurs — industriels, banques, groupes de services… — sont montés au créneau pour défendre cette position. Cet assentiment massif est très significatif dans une région du monde souvent montrée du doigt pour son peu d’empressement à protéger la planète.
P. I. — D’où vient la difficulté à créer un marché du carbone ? Vu de loin, cela ressemble un peu à mission impossible. Ou, du moins, on note un décalage entre les grandes déclarations de principe, qui évoquent la nécessité de s’accorder sur un cadre réglementaire, et la traduction opérationnelle, qui demeure très insuffisante. Le marché du carbone est-il voué à rester un dispositif ultra-théorique, avec quelques initiatives de ci de là, mais pas de colonne vertébrale ?
C. G. — Pour qu’une politique climatique soit efficace, il faut un prix du CO2 unique et universel. Un grand marché mondial des permis d’émission permettrait, en théorie, d’atteindre cet objectif. Si l’on ne tient pas cet objectif, le marché sera totalement inefficient. Pour le moment, d’un pays à l’autre, on relève des écarts de prix importants. En France, par exemple, les automobilistes affrontent un prix de la tonne de CO2 de 44 euros à la pompe, alors que les automobilistes allemands ou américains ne paient rien. Ces derniers n’ont donc aucune incitation à choisir de plus petits véhicules moins émetteurs de CO2. On en voit les conséquences en termes de parcs automobiles et en émissions ! On reviendra sur ces distorsions, qui créent obligatoirement un problème de concurrence entre les pays. En attendant, en Europe, pour donner une cohérence au système, l’application d’une taxe carbone unique serait la meilleure solution. Chacun serait logé à la même enseigne. Le problème, c’est que l’Union européenne n’a pas de pouvoir fiscal, la fixation des impôts et des taxes relevant de la souveraineté nationale.
Je raisonne à l’échelle de l’Europe car la première brique d’un marché du carbone est continentale. Il faut donc trouver un autre schéma pour bâtir ce marché. Cela tombe bien, un autre dispositif est déjà sur les rails : celui des permis d’émissions négociables. Même si là encore, pour le moment, on bute sur des différentiels de prix. Lorsque ce marché (EU-ETS) a été créé en 2005 pour couvrir les émissions de l’industrie et de l’énergie européennes, la tonne de carbone s’échangeait autour de 30 euros. À la fin de la décennie, elle s’est brutalement écroulée à 4-5 euros. La crise financière qui a ébranlé le monde occidental à partir de 2007-2008 a éteint la plupart des velléités de lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd’hui, l’exposition beaucoup plus importante de l’industrie allemande au risque de hausse de prix du permis CO2 crée une vraie tension avec la France qui voudrait une Europe plus ambitieuse sur le climat.
P. I. — Vous n’envisagez pas de marché du carbone en dehors de l’Europe. Mais la compétitivité des pays de l’Union européenne (UE) ne risque-t-elle d’en souffrir ?
C. G. — Les faits parlent d’eux-mêmes. À l’issue de la COP21 en décembre 2015, l’accord de Paris a suscité de grands espoirs avec un réel consensus autour de la lutte contre le réchauffement et un objectif précis de limitation de la hausse des températures. Mais très vite, les États-Unis ont pris leurs distances. Quant à la Chine, elle n’a rien fait pour relayer le mouvement amorcé. Parmi les grands pays, seul le Japon a donné le sentiment de vouloir épauler l’Europe dans le cadre d’une politique coordonnée en faveur d’une économie décarbonée. Pour en revenir à l’Amérique, elle n’est pas non plus complètement en dehors du jeu. Outre-Atlantique, l’essor du gaz du schiste a fait dégringoler le prix du gaz et a permis aux États-Unis de s’affranchir significativement du poids du charbon. Cette moindre dépendance doit être rangée dans la case des bénéfices climatiques, car le gaz naturel émet pratiquement moitié moins de CO2 que le charbon par kWh produit. En attendant, la distorsion des politiques climatiques entre les pays rend les écarts de compétitivité très graves à la fois pour les pays eux-mêmes et pour le climat. À ce rythme, qu’est-ce qui empêche les grandes entreprises de délocaliser leurs activités dans des régions du monde où elles seront moins impactées financièrement par la lutte contre le carbone ? Pas grand-chose, en tout cas à l’heure actuelle. Mais cela peut changer : une arme commerciale est envisageable, avec la possibilité d’une taxe aux frontières qui prendrait en compte l’empreinte écologique des produits et pénaliserait ceux dont la fabrication est la plus polluante. Ce dispositif est sûrement compliqué à mettre en place, mais il faut trouver un système qui récompense les pays les plus vertueux.
P. I. — Êtes-vous optimiste quant à la mise en œuvre de ces différents mécanismes ? Dans cette perspective, quel rôle les économistes de l’environnement ont-ils à jouer ?
C. G. — En France, nous avons la chance que le débat public ait depuis quelques années dépassé le point de savoir si l’homme était responsable du changement climatique. Mais une question lancinante demeure : comment organiser la société pour affronter notre responsabilité individuelle et collective envers les générations futures ? Il faut dire que le débat ne fait que commencer, alors que nous vivons dans l’utopie d’une transition énergétique heureuse. La France, comme beaucoup d’autres pays du Nord, ont déjà mis en place de nombreuses micro-politiques climatiques : les tarifs de rachat de l’électricité verte, les normes autos et d’isolation, le bonus-malus, les plans mobilités… Comme je l’explique dans mon livre Le Climat après la fin du mois, ces politiques ont un impact assez limité sur nos émissions de CO2, mais un impact majeur sur notre pouvoir d’achat. Une rationalisation de la dépense publique s’impose afin que chaque euro dépensé engendre un effet environnemental maximum. Comme l’expliquent les économistes depuis un siècle, c’est exactement l’objectif d’un prix du carbone !
P. I. — Quel est l’impact de la pandémie du Covid-19 sur la dynamique politique en faveur de la transition écologique ?
C. G. — La crise du coronavirus nous apprend d’abord que lorsque la volonté politique est là, il est possible de mobiliser le pays pour abattre un péril de cette taille. Même la jeunesse, qui ne risque pas grand-chose avec ce virus, a accepté de sacrifier sa liberté et sa capacité d’apprendre pour sauver essentiellement des personnes du troisième âge. Franchement, ce fut héroïque, en particulier au printemps. Tous les Français ont pu observer les effets positifs de leur comportement. Dans le cas du climat, et contrairement au coronavirus, un échec de la politique de prévention n’a aucune incidence sur les chances de réélection de nos représentants. Dès lors, il n’existe pas de majorité politique pour imposer au pays les sacrifices nécessaires. L’appauvrissement massif de la nation que le confinement engendre va se traduire par une forte hausse de l’endettement public, ce qui réduira d’autant notre capacité d’investissement. Il va donc probablement falloir mettre un coup de frein aux nombreux projets de subvention publique aux investissements verts. Du côté de l’opinion, on peut espérer un sursaut de même nature que le « plus jamais ça » de 1918. Sera-t-il suffisamment persistant, puissant et structuré pour mobiliser un large spectre de notre société et assumer nos responsabilités envers l’humanité ? L’histoire nous enseigne qu’en France comme ailleurs les forces sociales centrifuges sont capables d’annihiler rapidement la plupart des mobilisations altruistes.
P. I. — Comment jugez-vous les plans de relance français et européen décidés durant l’été ?
C. G. — Fallait-il se porter au secours des secteurs automobile et aéronautique ? Le politique est aujourd’hui confronté à deux objectifs : sauver les emplois et verdir l’économie. Les économistes savent qu’il faut un instrument par objectif : un plan de relance pour sauver les emplois ; et, simultanément, un mécanisme européen de tarification du carbone pour verdir l’économie. On n’a pas besoin de plomber l’économie en augmentant immédiatement le prix du carbone. Par contre, annoncer qu’un mécanisme crédible est décidé qui fera monter le prix du carbone rapidement conduira le secteur privé à réallouer ses investissements en accord avec l’ambition climatique du continent. Ces plans de relance sont indispensables pour lisser l’énorme choc économique et sauver les emplois à court terme. Le plan européen, rapporté au PIB, représente trois fois le plan Marshall ! Toute la difficulté va consister à allouer efficacement cet argent. À ce stade, il est difficile d’avoir un avis sur ce thème, tant les règles de dépense restent floues. Mais le fait que les États acceptent d’aider les pays les plus atteints par la pandémie est effectivement un événement historique. La création d’une dette commune l’est aussi. Nous sommes peut-être à un tournant de la construction de l’Europe. Il n’en reste pas moins qu’il nous faudra un jour rembourser cette dette. Et quand je dis « nous », il s’agit bien sûr des générations futures, celles-là même squi devront aussi affronter les conséquences de notre irresponsabilité climatique.
Cet entretien a été réalisé en novembre 2020.