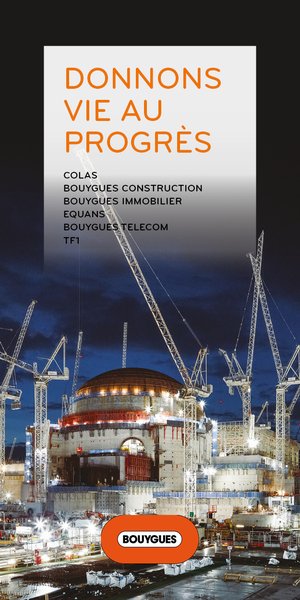Politique Internationale — Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à l’histoire de la monnaie ? S’agit-il d’un tropisme, d’un hasard ou d’autre chose ?
Daniel Dessert — Pour ma thèse de doctorat, j’avais choisi de travailler sur la marine de Louis XIV. En avançant, je me suis rendu compte que les principaux artisans de cette marine étaient des financiers — des personnages étonnamment complexes en raison de la diversité de leurs placements et de l’origine de leurs capitaux. D’où la réorientation de mon projet universitaire vers l’étude des financiers sous Louis XIV. Je voulais les connaître, connaître leurs familles et leurs relations, ainsi que la manière dont ils avaient contrôlé les rouages de l’État jusqu’à devenir les acteurs majeurs de la politique navale et du complexe militaro-sidérurgique. Ces individus étaient tout bonnement nécessaires au développement du royaume, État belliqueux par essence, pourrait-on dire. Car, entre 1661 et 1715, il fut en guerre près de huit années sur dix. Et près de sept années sur dix si l’on considère la période qui va du début des guerres d’Italie, en 1494, à la chute du Premier Empire en 1815 ! Or la guerre à outrance demande beaucoup d’argent. C’était le rôle des financiers de le procurer au roi de France.
P. I. — L’argent sert donc d’abord et avant tout à faire la guerre…
D. D. — Bien sûr. La France d’Ancien Régime ne connaît qu’un seul moyen libératoire pour toutes les dépenses, qu’elles soient régaliennes ou ordinaires : la monnaie métallique, c’est-à-dire les pièces d’or, d’argent ou de cuivre. Dans ce contexte, notamment durant le règne de Louis XIV, le budget militaire draine la plus grande partie de la masse monétaire métallique. Il faut rappeler la formule de Montecuccoli, général en chef des armées des Habsbourg, l’adversaire de Turenne : « Pour faire la guerre, il faut premièrement de l’argent, deuxièmement de l’argent et troisièmement de l’argent. » Difficile d’être plus explicite ! Sans rentrées d’argent dans les caisses de l’État, le maintien des armées ne serait plus assuré. Sans rentrées d’argent, elles seraient mal équipées. Sans rentrées d’argent, il n’y aurait pas de flotte de guerre, moyen nouveau, mais gourmand en investissements et en infrastructures. À tout cela il faut ajouter les dépenses utiles à la diplomatie étrangère : Louis XIV stipendie généreusement ses alliés.
P. I. — Sous l’Ancien Régime, ce sont donc les espèces métalliques qui constituent la monnaie ?
D. D. — Il existe deux types de monnaie dans le royaume : la monnaie de compte — la livre tournois — et les monnaies métalliques — l’écu d’argent, le louis d’or et le billion à base de cuivre. Celles-ci ne portent aucune valeur exprimée en livre tournois. C’est le pouvoir royal qui fixe leur valeur en monnaie de compte. Théoriquement, un écu vaut trois livres ; un louis, onze. Mais, au gré des besoins, l’État est tenté de modifier cette parité. Le système est d’autant plus opaque que les espèces françaises côtoient les pièces étrangères. Celles-ci circulent librement, comme la pistole italienne ou espagnole et permettent de conclure n’importe quelle transaction. Aussi les papiers financiers vont-ils s’imposer au XVIIe siècle en raison de l’insuffisance monétaire, certes, mais également parce qu’ils sont stipulés en monnaie de compte : ils échappent donc aux manipulations monétaires métalliques. Conséquence : dans le royaume cohabitent de facto une monnaie fiduciaire et des monnaies métalliques. En tout cas, les Français restent attachés à l’utilisation de la monnaie métallique. Tous les actes de la vie — acquitter une dot, acquérir une terre, une charge, emprunter une somme… — sont effectués en monnaie métallique. Ce n’est pas toujours d’emploi aisé. Ainsi, quand Mazarin dote ses nièces, les 600 000 livres versées à chaque contrat de mariage représentent 200 000 écus. Comme un écu d’argent pèse 27 grammes, plus de cinq tonnes d’argent doivent être décomptées et transportées ! Parfois même, c’est beaucoup plus. En 1662, lorsque Charles II d’Angleterre cède la place de Dunkerque à Louis XIV, il lui réclame cinq millions de livres en espèces : il faudra 46 charrettes escortées par les mousquetaires du roi pour les acheminer !
P. I. — L’argent, c’est aussi toujours plus d’argent. Comment l’État remplit-il ses caisses ?
D. D. — Théoriquement, le roi jouit de plusieurs types de revenus. En premier lieu, ceux de son domaine, qui recouvrent le produit du capital foncier et des droits qui lui sont afférents. En second lieu, ceux des droits qu’il reçoit en tant que seigneur de tous les seigneurs, ce qui se traduit par un prélèvement sur le produit de leurs domaines. Mais depuis la guerre de Cent Ans, cela ne suffit plus à couvrir les dépenses militaires. La monarchie a donc instauré un impôt direct levé sur tous ses sujets, encore que le clergé, « premier ordre » du royaume, et la noblesse, « second ordre » du royaume, en soient très largement exemptés. En fait, la taille repose sur le reste des sujets, qui constituent l’immense majorité. Bientôt pourtant, l’impôt direct ne suffisant plus, la monarchie multiplie les impôts indirects. Ils concernent la production et l’échange de marchandises, agricoles ou manufacturées. Le plus célèbre d’entre eux est l’impôt sur le sel : la gabelle. Là encore, le besoin d’argent se faisant de plus en plus pressant, la monarchie invente à partir du XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle les « affaires extraordinaires ». Elles correspondent à des emprunts et à des rentes, prêts gagés sur les recettes futures de l’État ; à des ventes de charges ; à des cessions de taxes sur des produits ou sur des groupes de particuliers. En période particulièrement délicate, l’État a pris l’habitude, en outre, d’utiliser les refontes monétaires, les variations du cours or-argent et les changements de rapport entre monnaie de compte et monnaies métalliques.
P. I. — Les impôts directs, les impôts indirects, les offices… Les ressources augmentent mais qu’en est-il de ceux qui collectent ces recettes ?
D. D. — En principe, chaque recette est collectée par une catégorie spécifique. L’impôt direct relève des receveurs généraux ou des trésoriers généraux en pays d’États, cas du Languedoc ou de la Bretagne. Ce sont des officiers comptables, des « fonctionnaires » royaux en quelque sorte. L’impôt indirect est affermé à des particuliers, les « fermiers généraux », qui prennent à bail la levée des taxes sur tout ou presque. Quant aux affaires extraordinaires, elles échoient aussi à des particuliers, par vertu cette fois d’un contrat passé avec l’État, un « traité ». D’où leur nom : les « traitants ». Ceux-là sont honnis de la France entière. Mais cette apparente diversité cache une vraie homogénéité, les officiers comptables pouvant être fermiers généraux ou traitants, ou les deux à la fois ! Ils sont des « financiers », vocable général. Ils sont définis par leur capacité à financer l’État en toute circonstance, ce qui signifie lui apporter le métal précieux que requiert son fonctionnement. Qu’il s’agisse de l’impôt direct, des impôts indirects ou des affaires extraordinaires, ce fonctionnement dépend des avances « sonnantes et trébuchantes » qu’ils consentent au Trésor royal. En somme, les financiers sont des chercheurs d’or : ils doivent convaincre les détenteurs de capitaux de leur confier cet argent pour le faire fructifier au service de l’État. Leur crédit tient aux emprunts souscrits à titre personnel auprès de tous ceux qui détiennent des liquidités. À savoir la haute noblesse de cour, d’épée, de mitre, de cloche ou de parlement. Parallèlement à l’utilisation du métal, l’essor de la finance et de la fiscalité génère une masse de papiers financiers. Stipulés en monnaie de compte, ils préservent des manipulations métalliques. Avec les difficultés budgétaires croissantes qu’occasionne la guerre, les rapports entre monnaie métallique et monnaie fiduciaire deviennent de plus en plus conflictuels.
P. I. — À partir de quel moment le billet de banque fait-il son apparition ?
D. D. — La distorsion entre la monnaie de compte et la monnaie métallique en circulation autorise les acrobaties d’un État aux abois. Ainsi, durant son règne, Louis XIV procède à 43 mutations monétaires et à 36 variations du rapport or-argent. Concrètement, en empruntant 120 livres quand l’écu en vaut 3, il encaisse 40 écus. Mais au jour du remboursement, en décidant que l’écu en vaut 4, il restitue 30 écus ! L’économie est loin d’être négligeable ! En raison de ces tripatouillages et de la difficulté grandissante de faire sourdre l’argent de toutes les cassettes du royaume, la monnaie papier apparaît peu ou prou comme un succédané des monnaies métalliques. Néanmoins, cette monnaie papier n’échappe pas toujours aux altérations. Ainsi, les emprunts souscrits par l’État en argent liquide devraient être éteints en argent liquide. Émises sous forme de papiers financiers, ces créances sont assignées sur des recettes de la Couronne et remboursables à terme. Faute d’être honorées comme prévu, elles sont prorogées et réassignées sur d’autres recettes. Il en va de même pour les emprunts que les financiers placent auprès du public. Au total, ces émissions engendrent une masse d’effets qui font l’objet d’une spéculation incroyable. Nombre de papiers financiers dépréciés sont rachetés au plus bas dans l’espoir d’être revendus au plus haut lorsqu’une caisse de recettes, momentanément solvable, les reprendra. Ces papiers ne sont pas des billets de banque, mais ils répondent à un besoin qui poussera à les inventer dans un contexte d’extrême pénurie de métal précieux.
P. I. — Quelles sont les conséquences de cette spéculation ?
D. D. — Évidemment, l’individu bien renseigné sait à quel moment liquider ses avoirs ou, inversement, rafler tout ce qui peut l’être, sachant que leur valeur va monter. Cela suppose une collusion entre affairistes et politiques, collusion éminemment profitable à certains. La preuve ? Des enrichissements aussi rapides que scandaleux. La fortune de Mazarin illustre le processus à un point jamais égalé. En mars 1661, le cardinal laisse une fortune vertigineuse, mais inexplicable : plus de 40 millions de livres. C’est la moitié du budget annuel du plus riche royaume d’Occident ! Premier ministre depuis vingt ans, il accumule ces millions sur ses huit dernières années, c’est-à-dire depuis son retour au pouvoir, une fois la Fronde vaincue (1652). Cette réussite spectaculaire interpelle car le pays est exsangue après vingt-cinq années de conflits (1635-1659, contre les Habsbourg et 1648-1652, contre les Frondeurs). Alors que les espèces métalliques font cruellement défaut au Trésor public, le cardinal amasse plus de 9 millions de livres en or et en argent, répartis en des lieux choisis pour faciliter leur exportation dans l’hypothèse de nouveaux troubles… La « cagnotte » de Son Éminence est supérieure à l’encaisse de la banque d’Amsterdam, le plus grand instrument de crédit de l’époque ! Mazarin possède également 10 millions de livres en papiers tout aussi suspects. Comment mieux illustrer le mélange des genres entre le milieu des financiers et la sphère des ministres ? Confronté aux besoins urgents du financement militaire, le monde des manieurs d’argent a pu contrôler l’État et la société en dépit des déclarations fracassantes d’un monarque prétendument absolu.
P. I. — Comment sont considérés les financiers et, par extension, les manieurs d’argent ?
D. D. — Assurément, ces gens ne jouissent pas d’une réputation sans tache ! Ils sont accusés de tous les maux. Ils sont soupçonnés d’origines ignobles et de malversations coupables. Au fond, ils sont surtout jalousés. Malgré l’opprobre et la vindicte, ce groupe traverse tous les orages, sauf la Terreur : nombre de fermiers généraux y perdront la tête. Pourtant, à l’instar des puissants dont ils plaçaient les fonds, les financiers sauront rebondir. Dispersés par la tempête révolutionnaire, les prêtres du Veau d’Or changeront de culte en conservant leur credo.
P. I. — Et la confiance dans la monnaie, quelle est-elle ?
D. D. — Sous l’Ancien Régime, la société française demeure fidèle à la monnaie métallique et au métal précieux. Les inventaires après décès sont explicites. Le plus humble a une croix d’or et quelques pièces. Le plus riche, des bijoux et des liquidités. Leur volume peut être imposant. Il est vrai qu’il est plus facile de dissimuler des louis ou des écus qu’un coffre. De fait, dans les périodes agitées, les fortunes « métalliques » sont faciles à cacher. En 1661, redoutant une disgrâce imminente, le surintendant Nicolas Fouquet confie à un ami 450 000 livres en liquide pour assurer le pain de ses enfants. De même, nombre d’établissements ecclésiastiques, dont les couvents de Paris, reçoivent des liquidités importantes, servant de la sorte de banques de dépôt. Cet attachement aux métaux précieux et à la monnaie métallique explique pour partie l’échec de John Law. L’essai dura cinq ans, de 1716 à 1720. Ce financier écossais ambitionnait d’éteindre la dette astronomique créée par la guerre perpétuelle. Il souhaitait démonétiser le métal précieux en lui substituant une monnaie nouvelle, fiduciaire celle-là, gagée sur les entreprises maritimes et coloniales du royaume. C’était abolir le système fisco-financier antérieur qui assurait la domination des publicains et de leurs bailleurs de fonds. Impossible cependant d’évacuer la première étape, celle qui attirerait les investisseurs : maintenir la convertibilité or des billets. C’était le point faible. Les gens d’affaires virent la faille. L’édifice fut fragilisé par l’agiotage extravagant des personnes bien informées. Elles étaient proches du pouvoir, voire au sein du pouvoir, tel Louis Henri de Bourbon-Condé, premier ministre et premier prince du sang. Elles encourageaient la spéculation sur ces effets puis réclamaient leur change en métal précieux, ce qui vida les caisses et interrompit la convertibilité. Par là même le programme s’écroula. Cet échec marqua profondément l’