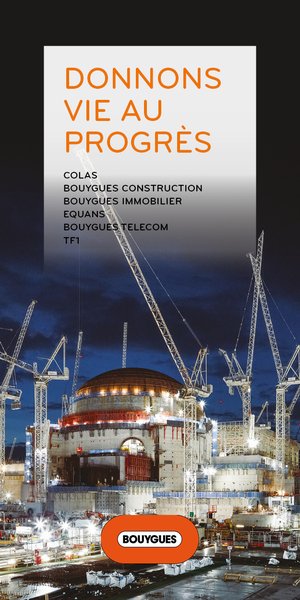Politique Internationale — Vous étiez président de la Banque centrale européenne au moment de la crise de 2008. La zone euro a tenu bon. Face à la nouvelle crise que nous sommes en train de vivre, diriez-vous que l’euro est un rempart ? Comment analysez-vous le rapport de force entre le dollar et l’euro ?
Jean-Claude Trichet — La zone euro et l’Europe ont, en effet, fait montre d’une résilience remarquable dans la crise des subprimes et la très grande crise financière des années 2007, 2008 et suivantes. Pour la zone euro, c’était le premier grand test. Aujourd’hui encore, oui, l’euro est un atout dans la crise pandémique. Il faut bien voir ce que la monnaie européenne représente. Avant la création de la monnaie unique, le dollar était la seule devise internationale, il était en position totalement hégémonique. Le dollar constituait 70 % environ des réserves de change et une part équivalente des émissions internationales d’obligations à long terme. Ensuite venaient, plus ou moins à égalité, le yen, le deutschemark, le franc français, la livre. Aucune de ces devises ne représentait plus de 5 % des réserves de change, la suprématie du dollar était écrasante. Depuis la création de la monnaie unique européenne en 2000, le paysage a profondément changé. Le dollar représente environ 60 % des réserves de change, mais l’euro en pèse désormais 20 %.
C’est un rapport de force très différent. La structure du système monétaire international a été profondément changée. Le rapport est de 1 à 3 (60 % à comparer à 20 %) entre le dollar et l’euro, et de 1 à 5 entre l’euro et la troisième monnaie le yen (20 % contre 4 %). Je suis persuadé que cela tient non pas à la monnaie — l’euro — qui est aussi crédible que le dollar, mais aux instruments financiers eux-mêmes. Aux États-Unis, qui sont une fédération politique, il y a un seul Trésor. Les Treasury Bonds sont les titres les plus échangés au monde. En zone euro, nous avons bien une même monnaie, mais les instruments financiers sont fragmentés. Sur le marché obligataire, les OAT françaises côtoient les Bunds allemands. Le marché obligataire est émietté entre divers marchés nationaux qui ne représentent qu’une proportion modeste du marché obligataire américain. Voilà le handicap de l’Europe : la signature unique des États-Unis donne une liquidité et une profondeur uniques au marché de New York. Le volume des transactions en valeurs du Trésor américain est vingt fois plus important que celui en Bunds allemands ou en OAT françaises !
P. I. — La crise née du Covid a une nouvelle fois obligé les banques centrales à accélérer la création monétaire. Pourquoi leur rôle est-il essentiel ?
J.-C. T. — Depuis le défaut de Lehman Brothers, les politiques économiques des pays avancés n’ont jamais cessé d’être extrêmement accommodantes. Les banques centrales n’ont pas pu relâcher leur effort en raison des problèmes des économies réelles. Depuis une dizaine d’années, la croissance potentielle était plus faible qu’avant la crise de 2008, et les progrès de productivité beaucoup plus lents depuis 2005. Au total, tout s’est conjugué, y compris la globalisation, la technologie et la démographie, pour produire une inflation très basse. Depuis la crise de 2008, les banques centrales se sont battues pour éviter la déflation. C’est dans ce contexte qu’est intervenue la crise du Covid. Il a alors fallu mettre en place une politique encore plus accommodante pour éviter une crise financière gravissime et une dépression pire qu’en 1929. Souvenez-vous du décrochage brutal de tous les marchés quand le monde a pris conscience de la sévérité de la pandémie ! Les banques centrales, la BCE, la Fed, la Banque du Japon n’avaient pas le choix. Elles ont abaissé encore les taux d’intérêt et amplifié leurs politiques non conventionnelles de rachat des actifs pour éviter que les économies ne sombrent. Les banques centrales et les gouvernements ont pris des mesures colossales. Sans ces actions, nous serions en train de vivre une dépression des économies réelles monumentale au niveau mondial.
P. I. — Peut-on continuer longtemps comme cela, avec des banques centrales qui jouent aux pompiers et tiennent à bout de bras les économies ?
J.-C. T. — Non, et nous le savions déjà avant la pandémie. Le régime antérieur de politiques accommodantes des banques centrales n’était pas tenable sur la durée. Avant même le Covid, il était clair qu’un changement était nécessaire. Quelques chiffres : la Fed américaine a déjà, dans son bilan, 45 % environ des valeurs négociables du Trésor. Cette part est la même pour le Trésor japonais. En Europe, la proportion est moindre. Mais il est clair qu’une augmentation continue de ces proportions n’est pas soutenable à moyen ou long terme. Pas plus que ne peut et ne doit être durable l’inflation anormalement basse, frisant la déflation.
P. I. — Une fois la pandémie derrière nous, comment revenir à des politiques monétaires plus conventionnelles ?
J.-C. T. — Les banques centrales ne sont pas maîtresses de l’économie réelle. Dans ce domaine, on a besoin des gouvernements, des parlements et du secteur privé avant tout. Pour sortir de la situation où nous nous trouvons, il faut augmenter les gains de productivité. C’est l’une des principales anomalies de l’économie réelle alors que nous sommes dans une phase de progrès technologique important. Il va falloir mettre en place des réformes structurelles pour rendre les économies avancées plus agiles, plus adaptables, pour renouer avec la croissance. Par ailleurs, dans les pays qui connaissaient le plein-emploi avant la pandémie — c’était le cas des États-Unis, du Japon, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Suisse —, les augmentations de revenus et de salaires restaient anormalement basses. Et cela expliquait, dans une certaine mesure, la faible inflation. Dans tous ces pays — la France n’était pas concernée, puisque nous étions malheureusement loin du plein-emploi —, les employés, les ouvriers et les syndicats préféraient arbitrer en faveur de la préservation de l’emploi plutôt que des augmentations de salaires. La combinaison des réformes, des progrès de productivité et du renforcement du « bargaining power » des employés dans les pays au plein-emploi doit permettre de desserrer progressivement l’étau.
P. I. — La crise sanitaire s’est donc abattue sur une Europe à deux vitesses et des tensions se font jour. La zone euro, la monnaie européenne ne sont-elles pas remises en question une fois encore ?
J.-C. T. — Je m’inscris totalement en faux contre l’europessimisme. L’Europe a fait preuve d’une forte résilience dans toutes les crises mondiales qui se sont succédé. Entre 2007 et 2010, elle a résisté à une crise épouvantable qui n’était pas née en Europe ; elle était née aux États-Unis avec les défauts des subprimes et la faillite de Lehman Brothers. Mais l’Europe a su éviter de telles catastrophes. Je peux vous le dire, puisque j’étais alors président de la Banque centrale européenne ; il aurait pu y avoir sept ou huit Lehman Brothers européens. Or nous n’avons pas eu un seul dépôt de bilan d’établissement financier, preuve de l’efficacité de la réaction immédiate des autorités européennes. L’illustration la plus remarquable de cette solidité dans l’orage peut être résumée en deux chiffres : quinze et quatre. Les quinze pays, qui étaient dans la zone euro le 15 septembre 2008 lors du dépôt de bilan de Lehman Brothers, sont restés dans l’euro, y compris la Grèce qui était le plus vulnérable. Et quatre nouveaux pays sont entrés dans l’euro en pleine période de crise, après Lehman Brothers : la Slovaquie et les trois États baltes. Ainsi, le nombre de pays membres de la zone a augmenté de plus du quart après le déclenchement de la crise.
P. I. — Quelle est votre analyse de la crise actuelle ?
J.-C. T. — La pandémie est un formidable accélérateur d’évolutions économiques, sociales et politiques qui étaient sous-jacentes. Je pense à la transition verte, à la digitalisation, à la perception des inégalités, au réexamen de la mondialisation… Et l’Europe elle-même accélère sa construction, comme en témoigne le programme d’emprunt « Nouvelle génération » de 750 milliards d’euros. C’est la première fois qu’un emprunt massif est lancé avec la signature de l’Europe. L’Europe doit renforcer sa capacité stratégique dans un monde en grande transformation. De nombreuses nouvelles puissances émergent en sus des États-Unis et de la Chine : Inde, Brésil, Mexique, Indonésie, Russie, Turquie, etc. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe n’avait affaire qu’à une seule puissance — les États-Unis — qui était son grand modèle économique. Aujourd’hui, elle s’inscrit dans une large constellation mondiale de puissances émergentes en croissance rapide. Il y a encore plus de raisons de faire l’Europe aujourd’hui qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale !
P. I. — La crise sanitaire a vu une augmentation des transactions par cartes bancaires au détriment de celles par billets ou pièces. Selon vous, cette tendance est-elle durable ?
J.-C. T. — La monnaie électronique, les transactions par cartes bancaires se sont beaucoup développées. Il existe une différence majeure entre ces instruments de paiement : billets et pièces sont totalement anonymes, alors que les transactions par cartes bancaires laissent des enregistrements comptables. La monnaie électronique offre donc une transparence que n’ont ni les pièces ni les billets. Des réflexions sont menées en ce moment sur l’avenir de la monnaie. Certains espèrent, les Suédois par exemple, que les billets de banque disparaîtront complètement. Au-delà même d’une simplification majeure, ils considèrent que cela favorisera une plus grande transparence dans la lutte contre le crime organisé, l’argent sale, les trafics de tous ordres et le financement du terrorisme. D’autres voix défendent l’idée qu’il faut conserver un usage important des pièces et surtout des billets, qu’il s’agit d’un élément de liberté. C’est un grand débat des dernières années. Les coupures les plus importantes sont en train de disparaître ; les États-Unis ont ainsi abandonné tous les billets supérieurs à 100 dollars. La monnaie électronique se généralise, la crise sanitaire a conduit à porter le plafond des paiements sans contact à 50 euros en France, ce qui élimine un grand nombre d’échanges de billets et de pièces. Le mouvement de fond mondial va dans le sens de la monnaie électronique contre les billets.
P. I. — Quel regard portez-vous sur les cryptomonnaies ? Les voyez-vous comme un risque ou comme une piste d’avenir ?
J.-C. T. — Il y a plusieurs formes de cryptomonnaies. Je suis totalement hostile au « bitcoin » et aux monnaies analogues. D’abord, parce que ce ne sont pas des vraies monnaies. Selon Aristote (et on n’a pas trouvé de meilleure définition depuis), une monnaie doit remplir trois fonctions : elle doit être un bon instrument de compte, un bon instrument d’échange et un bon instrument de conservation de la valeur. Cette dernière fonction est absente des cryptomonnaies de type « bitcoin ». Ce sont des instruments spéculatifs qui ne prétendent pas conserver la valeur. Les cryptomonnaies de ce type ont été explicitement créées pour faciliter les transactions à l’écart de toute intrusion des autorités publiques. C’est donc une catégorie nouvelle d’instruments de paiement qui s’inscrit de facto contre ce que la communauté internationale organise pour lutter contre la corruption, la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. On peut imaginer, bien sûr, de prendre avantage des progrès technologiques considérables qui ont été réalisés (blockchain) et sont encore à venir. Par exemple, en créant des cryptomonnaies internationales permettant des règlements immédiats à très faible coût, dont la conservation de la valeur serait assurée grâce à un ancrage à un panier de monnaies internationales. C’est l’ambition du projet Libra de Facebook. Mais l’apparition d’un circuit de paiement fermé, dominé par les plateformes géantes, comporte des risques énormes pour la concurrence et pour la protection des données. Pour moi, un tel concept n’est imaginable que sous le contrôle rigoureux des banques centrales. En tout état de cause, les banques centrales ne peuvent négliger les progrès extraordinaires de la technologie. Elles réfléchissent toutes actuellement à la possibilité d’émettre des cryptomonnaies de banque centrale qui seraient l’équivalent des billets de banque. Cela pose de nouvelles questions auxquelles il faudra répondre : comment transposer aux cryptomonnaies de banque centrale les limitations apportées aux montants maximum des billets de banque (limite des 100 dollars aux États-Unis) ? Comment réorganiser les relations entre banques centrales et banques commerciales si l’on peut avoir un compte en cryptomonnaie à la banque centrale ? Les comptes à vue dans les banques commerciales ne vont-ils pas disparaître ? Une chose est sûre : les progrès technologiques actuels et à venir vont induire des transformations structurelles monumentales en matière de monnaie et de paiement. Il ne faut surtout pas les ignorer.