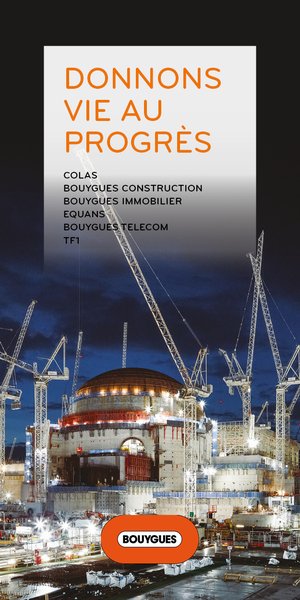Politique Internationale — Le fait de pouvoir battre monnaie est-il le critère le plus important de la souveraineté nationale ?
Dominique de Villepin — La monnaie est un enjeu central de notre époque parce qu’elle se trouve à l’intersection de trois types de problématiques de ce nouvel âge conflictuel de la mondialisation : d’abord, la possibilité d’échanges commerciaux et financiers garants de stabilité et de prospérité ; ensuite, l’expression d’une forme de souveraineté de l’État ; et, enfin, la participation à la manifestation d’une identité collective nationale.
La monnaie, c’est aussi un enjeu d’aujourd’hui qui résonne avec les débats sur la technologie, avec la digitalisation d’une partie des échanges monétaires, que ce soit par les banques centrales ou dans le cadre d’initiatives privées de plus ou moins bon aloi. Quand on voit Facebook créer la Libra, on est face à la possibilité inouïe d’une monnaie globale privée, assise sur la confiance que les utilisateurs d’un réseau de communication placent dans les organisateurs de ce réseau. Bien plus que le bitcoin, il s’agit d’une monnaie sans État qui cherche à s’imposer parmi les monnaies des États. Je ne suis pas sûr que nous ayons à ce jour mesuré toutes les implications de ces évolutions. Pour l’heure, Facebook a mis de l’eau dans son vin, réduit la portée du projet et allongé le calendrier mais, une fois dans la place, ce concurrent nouveau jouera nécessairement un rôle important.
P. I. — Et quel est le rôle de la monnaie fiduciaire ?
D. de V. — La monnaie fiduciaire, c’est d’abord un attachement affectif à un objet, une pièce, un billet, qui exprime une sorte de continuité, de mémoire collective. Dans tous les pays où j’ai pu me rendre, j’ai toujours été frappé par la propension des gens à vous expliquer leurs billets, les symboles qu’ils portent, les personnages qu’ils honorent. C’est le manuel d’Histoire des rues. En France, vous trouvez encore de nombreux nostalgiques qui se souviennent des billets « Delacroix » par exemple, ou des « Molière » de la génération précédente.
C’est en même temps l’un des rares signes concrets de la puissance de l’État. Car c’est l’État qui conserve le monopole de la frappe et de l’impression — ce que rappelaient jadis les articles de loi sur la répression du faux-monnayage inscrits sur les billets. Aujourd’hui, grâce aux technologies d’impression, les niveaux de sécurité des billets ont donné un avantage spectaculaire aux États dans cette lutte. Mais il y a un dernier aspect qui m’intéresse encore plus, c’est que la pièce de monnaie, le billet sont l’incarnation même de la confiance, qui est le socle et en fait la seule réalité de la politique. Ces objets n’ont de valeur d’échange que parce que nous accordons notre confiance à ceux qui les ont émis et nous disent « voilà sa valeur officielle ». Un pays en hyperinflation, le Venezuela ou le Zimbabwe dans l’histoire récente, est un pays où le peuple a cessé de croire à l’État ; où la confiance minimale qui permet de faire société a disparu. La confiance entre les personnes se rompt également, et avec elle les échanges, entraînant misère et pénurie. La monnaie est à la fois signe et signal.
P. I. — Le lien entre le peuple et la monnaie est donc victime d’un État qui s’affaiblit…
D. de V.— Nous sommes entrés dans un nouvel âge des nationalismes, non tant parce que le sentiment national serait vigoureux, mais surtout parce que l’État semble faire défaut, ses protections semblent se retirer, ses limites semblent se brouiller. C’est pourquoi, dans la mondialisation, la dimension symbolique de la monnaie me paraît au moins aussi importante que son aspect instrumental. Depuis toujours, la frappe de la monnaie — et depuis quelques siècles l’impression des billets de banque — est un signe de la force et de la crédibilité d’un État. Un exemple parmi tant d’autres : Philippe de Macédoine qui, frappant des statères d’or, venait concurrencer le prestige du Grand Roi vécut comme l’ennemi héréditaire perse des cités grecques. Un autre plus proche : face à la défaillance de l’État central en Allemagne en 1923, les communes ou les districts se sont mis à émettre des monnaies provisoires, l’« argent d’urgence », décoré de vers de Goethe ou de gravures modernistes pour signaler soit une tradition digne de confiance, soit une innovation source de croissance dynamique.
La monnaie est aussi le symbole de l’identité d’un peuple se montrant à lui-même ses grands accomplissements, ses grands hommes. C’est en réalité un objet essentiel, quotidien, populaire, résilient qui n’a pas vocation à disparaître. C’est la croissance démographique qui dicte les besoins, davantage que des révolutions technologiques proclamées d’en haut.
P. I. — La naissance de l’euro, il y a presque vingt ans, s’est-elle traduite par une perte de souveraineté pour les pays européens ?
D. de V.— L’euro a provoqué un bouleversement identitaire, mais pas à strictement parler un transfert de souveraineté. Simplement parce que celui-ci avait déjà eu lieu avec la décision du Système monétaire européen (SME) d’instaurer des parités fixes. Mais il a rendu ce choix irréversible, il l’a ancré dans la nouvelle identité commune.
On confond souvent souveraineté étatique et souveraineté nationale. La monnaie exprime d’abord, et cela depuis toujours, l’autorité d’un État, d’une institution publique capable de contrôler la production et la diffusion du signe monétaire. Une zone économique cohérente suppose une unité de valeur commune. C’était l’étalon-or hier, c’est l’euro aujourd’hui. Sinon, on se retrouve avec une multiplicité de risques de change qui entravent l’initiative et donnent une place démesurée au système financier. Ce n’est pas tant l’affaire du peuple, ou de la nation, que d’un acteur institutionnel agissant en fonction d’un mandat d’efficacité. À ce titre, le passage à l’euro marque moins la perte d’une identité nationale que le regain d’une souveraineté partagée, mise à mal par la mondialisation et la fin de la prééminence européenne dans le monde après-1945.
P. I. — La transformation programmée du franc CFA en éco relève-t-elle de la même logique ?
D. de V. — Il s’agit, là aussi, d’un problème d’adéquation entre la taille du marché et la circulation de la monnaie. Ce mouvement de transformation du CFA en éco est l’occasion de créer des espaces économiques dynamiques, de développer une réflexion commune entre États africains sur les symboles qui pourraient donner à leurs peuples le sentiment d’une monnaie porteuse de sens et d’avenir. Il était important de répondre aux polémiques et aux malentendus qui s’étaient installés avec le temps sur le rôle de la France dans le franc CFA. Désormais, la France a donné toutes les garanties de stabilité. C’est maintenant aux États de la région d’engager une réflexion et une concertation profondes avec les sociétés civiles et les partenaires globaux pour permettre à cette monnaie refondée d’être un nouveau point de départ économique et un message de dynamisme adressé au monde.
P. I. — Peut-on encore parler de dictature du dollar ?
D. de V. — Fidèle à l’héritage du général de Gaulle, je suis toujours resté sceptique sur le rôle exclusif joué par le dollar dans les échanges internationaux au cours du dernier demi-siècle. À mon avis, ce n’est sain ni pour les échanges mondiaux, ni pour les États-Unis eux-mêmes. Depuis que les États-Unis se sont désarrimés de la convertibilité en or, sur décision unilatérale de Richard Nixon en 1971, nous vivons dans un système mondial de changes flottants accrochés au plus grand des radeaux : le dollar. Les monnaies flottent avec lui, dérivent par rapport à lui, au gré de la conjoncture économique, mais il n’y a plus d’étalon commun. Il en résulte une forte volatilité des changes et une multiplication des crises monétaires. On se souvient des attaques violentes qu’ont subies les monnaies européennes, notamment la livre sterling, dans les années 1990.
D’abord, cette prééminence du dollar confère aux États-Unis une sorte de droit de seigneuriage sur le monde entier. Les acteurs économiques mondiaux, qui ont envie et besoin d’acquérir des dollars, soutiennent mécaniquement son cours et évitent que des taux d’intérêt élevés ne brident la création monétaire américaine. Le dollar devient une sorte de piscine à débordement qu’on peut remplir à loisir et dont les surplus se déversent à l’extérieur. C’est ce mécanisme qui, depuis les années 1980 et à nouveau avec les années Trump, a produit les « déficits jumeaux ». L’Amérique, en un mot, vit à crédit et fait financer par le reste du monde ses déficits commerciaux et budgétaires colossaux. Cette situation n’est pas saine et explique, pour une large part, les maux dont souffrent les États-Unis : la désindustrialisation, la financiarisation et la persistance des inégalités. L’élection de Trump en 2016 et le chaos électoral de 2020 en sont en quelque sorte des sous-produits.
P. I. — En attendant, les États-Unis ne sont pas près de renoncer à cette mainmise…
D. de V. — Ce pouvoir du dollar est également dangereux parce qu’il a des implications politiques de plus en plus lourdes. J’ai été très choqué par la manière dont le dollar a été utilisé comme une arme dans le cadre des sanctions contre l’Iran notamment. En 2015, la banque française BNP Paribas a été poursuivie en justice aux États-Unis pour violation de ces sanctions du seul fait qu’une partie des transactions concernées s’étaient effectuées en dollars. En somme, se servir de dollars, c’est se rendre justiciable des lois américaines, partout et toujours. Cette insécurité juridique globale favorise en réalité la « dédollarisation » de l’économie dans de nombreuses régions du monde qui craignent une instrumentalisation politique des sanctions.
Enfin, cette domination du dollar est aujourd’hui en décalage avec les réalités de la montée en puissance des pays émergents, au premier rang desquels la Chine. À l’horizon 2050, cette hégémonie ne sera plus tenable. Pour prévenir une guerre froide des monnaies, il faut dès maintenant, comme je le propose depuis des années, poursuivre sur la voie d’une multilatéralisation de la stabilité financière en mettant en avant des unités de compte représentatives des transactions réelles, à l’image des droits de tirage spéciaux émis par le FMI à partir d’un panier de devises. Je crois aussi à la nécessité d’un G3 des banques centrales européenne, chinoise et américaine afin de prendre les mesures nécessaires à la garantie de la stabilité financière mondiale. Je veux croire qu’avec l’élection de Joe Biden les États-Unis prendront conscience qu’il est urgent de passer du statut de puissance mondiale à celui de puissance mondialisée, c’est-à-dire insérée dans un réseau de concertations, de responsabilités et d’initiatives collectives où ils pourront assumer un rôle de boussole.
P. I. — En marge de la monnaie, les critères de la souveraineté sont-ils les mêmes aujourd’hui qu’hier ? Qu’est-ce qui a changé ?
D. de V. — Les critères de la souveraineté n’ont cessé de s’étendre à mesure que les sociétés contemporaines ont complexifié leurs relations et leurs actions. De nouveaux espaces se sont ouverts, sur lesquels se pose la question de la part de souveraineté revenant à chaque État. C’est le cas du cyber-espace par exemple, des océans, du ciel et de l’espace.
Les deux dernières décennies nous ont enfermés dans un débat réducteur : préserver ou perdre sa souveraineté, comprise comme un contrôle administratif d’un certain nombre de réalités — frontières extérieures, monnaie, règles commerciales, ressources énergétiques. Il est bien plus sensé de considérer la souveraineté comme le cadre d’efficacité de l’État de droit. L’enjeu, c’est la prévalence de la loi contre l’arbitraire privé, certes, mais aussi contre l’arbitraire d’État. C’est pourquoi nous devons surtout trouver le bon niveau de règles. Aussi bien pour les frontières que pour la monnaie, nous ne cédons pas notre souveraineté lorsque nous sommes parties prenantes d’une décision à un niveau plus large, plus adapté au respect de ces règles. Nous devons réduire les dissonances entre le niveau national et le niveau européen, mais pas nous recroqueviller sur une lecture réductrice de la souveraineté.
P. I. — La crise sanitaire a encore exacerbé les frictions avec la Chine (origine du virus, gestion des approvisionnements…). Diriez-vous que la tension est un peu retombée ?
D. de V. — Il s’agit pour beaucoup d’un faux débat, lié parfois à la volonté de faire oublier les défaillances locales dans la lutte contre la pandémie. Ce défi doit être relevé de façon globale et coopérative. Or, pour l’instant, la coopération internationale a largement failli au profit du chacun pour soi. Force est de constater que les pays asiatiques — Chine, Corée du Sud, Japon… —, sans doute préparés par les épidémies de SRAS et de MERS du début du siècle, ont mieux réussi à endiguer et à limiter l’impact de l’épidémie. Mais la coopération peut encore être sauvée à deux conditions. D’une part, nous devons tirer les leçons des défaillances afin de réformer le fonctionnement et les prérogatives de l’OMS. Il faut mettre en place un système de veille précoce des risques et former des personnels, notamment dans les pays fragiles. N’oublions pas que les pays les plus touchés sont en fait les pays émergents et en voie de développement où seule une partie des chiffres est connue. D’autre part, il faut établir un mécanisme collectif de production, d’acheminement et de distribution des vaccins disponibles contre le coronavirus dans les prochains mois, dans la lignée de l’initiative Covax de l’OMS et de l’ONU.
P. I. — D’une manière générale, jusqu’où cette crise affecte-t-elle les grands équilibres internationaux ?
D. de V. — On le voit de plus en plus clairement. L’enjeu de la décennie à venir est de savoir si le monde se casse en deux blocs conflictuels ou s’il s’équilibre autour de trois pôles principaux. À l’heure où le conflit entre Chine et Amérique s’installe dans la durée et creuse ses tranchées, c’est paradoxalement à nouveau en Europe que se décide le nouvel ordre international. C’est ce qu’Emmanuel Macron porte à travers sa conviction d’une « souveraineté européenne ». Si nous voulons garantir notre sécurité et la paix dans le monde, nous devons consolider nos leviers d’indépendance, comme le fait Thierry Breton à la Commission européenne sur les enjeux économiques, technologiques et numériques. La partie est loin d’être gagnée, tant les Européens sont prompts à la division et tant nous semblons parfois craindre de saisir pleinement notre autonomie stratégique.
P. I. — Quid de l’urgence écologique ? Va-t-elle passer au second plan ?
D. de V. — L’urgence écologique n’est pas une crise parmi d’autres. Elle est une crise génératrice de crises, parce qu’elle produit des risques politiques, sociaux, économiques multiples. Mais elle est aussi une crise de civilisation. Elle pose à l’humanité une seule et unique question : le modèle de développement fondé sur la maîtrise de plus en plus intense par l’homme de son environnement et des forces naturelles est-il en mesure de trouver les remèdes à ses propres excès ou ce modèle de civilisation doit-il être révisé de fond en comble pour remédier aux sources mêmes de ces excès ? Il y a, d’un côté, ceux qui pensent que la mobilisation de moyens financiers et technologiques nouveaux permettra de maîtriser la nature et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. De l’autre, il y a ceux qui voudraient que nous bridions nos désirs et nos pulsions afin d’inventer une société plus sobre, où il s’agirait de maîtriser l’homme plus que la nature. Mais étant donné l’urgence, je pense que nous devrons nous résoudre à un panachage de ces deux approches : nous devons engager notre changement collectif et, en même temps, développer les leviers pour mieux maîtriser énergies et ressources.