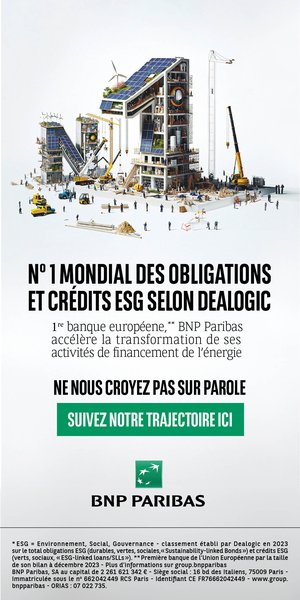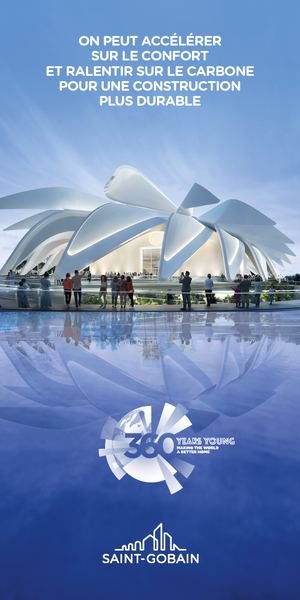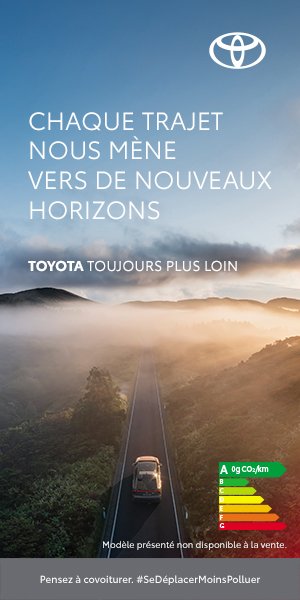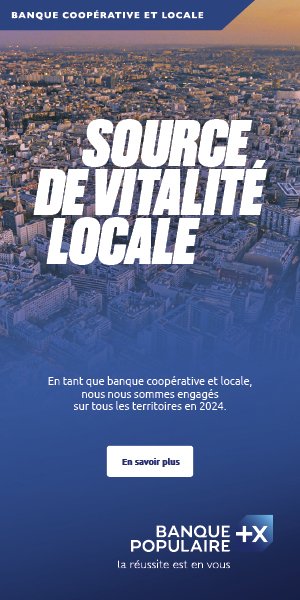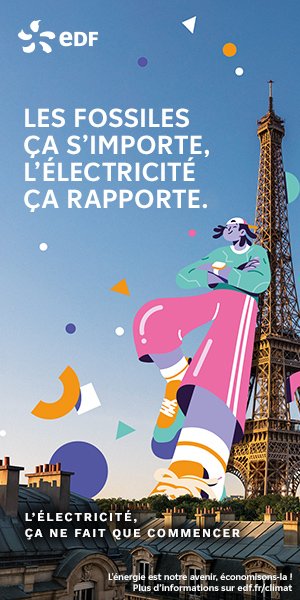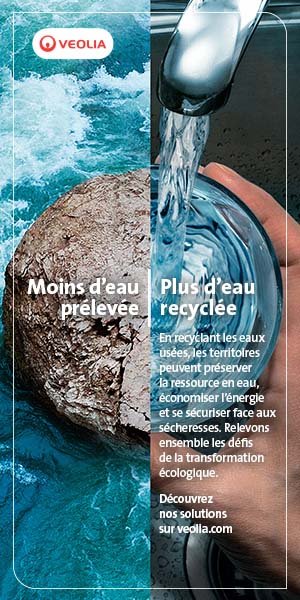Politique Internationale — Jusqu’à quel point le risque social est-il aujourd’hui prégnant ?
Christian Le Roux — Nos compatriotes, contrairement aux habitants d’autres pays voisins, ont depuis plusieurs années un sentiment de déclassement de plus en plus présent. Peur de perdre son pouvoir d’achat, peur de l’étranger, peur du voisin, peur de l’avenir, peur de la science, peur environnementale, en fait peur de l’inconnu. Pourtant, jamais notre société n’a développé autant d’outils de solidarité et de proximité. C’est l’un des paradoxes des Français qui bénéficient d’un système de protection sociale solide, d’un système de santé que beaucoup nous envient, d’une situation de l’emploi favorable, d’un système éducatif pour tous… Le monde associatif est donc devenu une boussole et un repère pour bon nombre de nos concitoyens qui se sentent délaissés. C’est la mission de Bleu Blanc Zèbre de recenser, de réunir et de dupliquer toutes les actions positives qui fleurissent dans tous les territoires, ruraux, péri-urbains, urbains.
P. I. — Votre engagement est fort et ancré dans le temps, depuis dix ans déjà. Quels sont ses ferments ?
C. L. R. — En 2014, le Front national arrive en tête à l’issue des élections européennes. L’événement, déjà, résonne fort. Il soulève aussi des inquiétudes. L’écrivain Alexandre Jardin vient alors me voir au Conseil économique, social et environnemental (CESE), où je travaille comme directeur de cabinet du président Jean-Paul Delevoye. Il est remué par le score des élections, mais sait aussi que les territoires fourmillent d’initiatives susceptibles de redonner de l’espoir et de l’énergie à des gens en proie à un sentiment d’abandon et à une peur du déclassement. Les ferments de Bleu Blanc Zèbre sont là : comment réinsuffler du dynamisme grâce aux forces portées par tout le tissu associatif.
En moins de trois mois, nous allons donner une traduction opérationnelle à cette belle aspiration. Les politiques jouent un rôle important : lors d’un événement au CESE, des personnalités comme Alain Juppé, Anne Hidalgo, Jean-Paul Delevoye ou encore Xavier Bertrand appuient cet engagement. Les uns et les autres, nous sommes convaincus qu’une association qui serait en quelque sorte la plateforme des associations est un outil très pertinent pour fédérer les énergies. Cette approche peut sembler théorique, mais elle se nourrit de quantité de cas pratiques observés au quotidien : par exemple, la famille dont un enfant vient d’être sévèrement accidenté et qui se mobilise pour lui trouver un cadre de vie ; dans une autre veine, moins dramatique, les adeptes d’un sport méconnu qui cherchent à étoffer le vivier des pratiquants ; ou encore ces personnes qui, pour pallier les difficultés de segments de la population à utiliser Internet, entendent les aider. Autant de démarches collectives dont nous nous disons, chez Bleu Blanc Zèbre, qu’elles pourraient être dupliquées avec profit, à la condition bien sûr que la communication circule et que les gens soient avertis de ce qui se passe ailleurs.
P. I. — Si vous deviez dresser le bilan des actions entreprises, sur quels dossiers insisteriez-vous en priorité ?
C. L. R. — Parlons, dans un premier temps, des territoires ruraux. Trop souvent, on circonscrit les difficultés sociales à l’univers des villes, voire des grandes villes, alors que les campagnes sont également très impactées. La désertification médicale est ainsi devenue une réalité extrêmement problématique. Parallèlement, la récurrence des zones blanches reste alarmante : à l’heure de la révolution numérique, un trop grand nombre de foyers sont encore privés des outils inhérents. Nous nous intéressons plus particulièrement aux communes de 500 à 3 500 habitants où un poste en particulier est exposé, celui de secrétaire de mairie. C’est bien simple, on demande tout ou presque à l’intéressé(e) : d’être à la fois maire, avocat, prestataire de services, psychologue même ! Cette charge est beaucoup trop lourde, au risque de décourager les vocations. Bleu Blanc Zèbre a choisi de déployer une méthode intitulée « les défis des maires » : elle n’est pas réservée à l’environnement rural mais y prend une certaine acuité. Concrètement, parce que l’on bute sur des obstacles communs dans le Calvados, le Cantal, le Var ou l’Aveyron, il est profitable de faire part de ses difficultés pour que cette bourse aux problèmes se transforme en bourse aux solutions. Je me sentirai certainement moins seul et moins démuni si j’apprends qu’à quelques centaines de kilomètres de chez moi une autre personne a eu recours à ce moyen pour dénouer telle ou telle complication.
P. I. — Les campagnes mais aussi les quartiers : les banlieues sont- elles vouées à rester éternellement l’épicentre du risque social ?
C. L. R. — L’ancrage de Bleu Blanc Zèbre dans les banlieues nous permet de disposer d’une série de capteurs, extrêmement instructifs quant à l’état de la situation. Les banlieues sont trop souvent stigmatisées : à entendre certains commentaires, elles se réduiraient au trafic de drogue, aux caves, théâtres des agressions les plus sordides, aux multiples circuits illicites… Pas question bien sûr de minorer ces dérives et ces exactions, mais les quartiers se révèlent aussi un terreau extrêmement fertile pour relayer des initiatives dynamiques. Je pense à cette association, Zup de Co, qui contribue à favoriser l’accès d’élèves défavorisés au réseau des écoles de commerce. Zup de Co est loin d’être un exemple isolé : des interventions destinées à élargir l’éventail des opportunités pour s’ouvrir un avenir, on en trouve plusieurs, dans des domaines variés. J’insiste sur ce foisonnement car il est réel : les quartiers sont eux aussi un vivier de solutions.
P. I. — Vous avez évoqué l’importance du dialogue avec les élus. Face au risque social, ces derniers sont-ils en mesure de faire bouger les lignes ?
C. L. R. — Les élus ont besoin d’être informés. Avec l’objectif, pour nous, de leur faire remonter le maximum d’informations qui leur permettent d’avoir une vue très claire des situations. Nous avons lancé un événement baptisé « Territoires et solutions ». Le principe est celui de rendez-vous réguliers, capables d’associer un grand nombre d’interlocuteurs, à commencer par les élus, dans un cadre où la parole est libre et où ils peuvent, en fonction de leurs problématiques, rencontrer nos Zèbres. Pas n’importe lesquels, puisque nous interrogeons en amont les réseaux d’élus sur les problèmes les plus importants pour eux à court et moyen terme. Nous les classons par catégories (répondre au vieillissement de la population, construire une offre périscolaire en milieu rural, orienter les jeunes…), nous identifions les Zèbres ayant développé une méthodologie à impact validée sur ces questions, et nous rendons possible le partage de solutions et la mise en réseau, immédiatement après l’événement. En avril, par exemple, nous avons réuni plus de 800 personnes — y compris des fonctionnaires territoriaux et des représentants d’associations bien sûr — qui ont pu échanger sur les sujets les plus prégnants. En l’occurrence, nous sommes aux antipodes d’assertions théoriques : le but est d’embarquer tout le monde autour de solutions innovantes et susceptibles d’être rapidement mises en place. En parallèle, nous déployons une autre initiative, dénommée « la Route en communes » : il s’agit d’aller à la rencontre des élus, de réaliser un sondage grandeur nature en quelque sorte, pour mesurer au plus près les difficultés qu’ils doivent affronter. Je reviens à cette notion de capteurs : Bleu Blanc Zèbre emmagasine une foule d’informations qui étayeront le déploiement de solutions.
P. I. — La révolution digitale : elle est présentée comme un formidable progrès alors même que la fracture numérique est une réalité tangible. Qu’en pensez-vous ?
C. L. R. — Cette révolution technologique ne profite pas encore à tout le monde. Pour les sachants, le gain est formidable : des tâches s’accélèrent, la soif de curiosité est étanchée, des liens se tissent et se renforcent… Mais ceux qui ne savent pas, pour lesquels une tablette est un objet difficile voire impossible à manier, se sentent de plus en plus exclus. Combien d’activités quotidiennes sont désormais accessibles uniquement par Internet ? Si le virage technologique garde cet aspect à deux vitesses, des inégalités vont se creuser très dangereusement. La pédagogie numérique, avec une dimension induite en termes de formation, doit s’ériger comme une priorité. Certains de nos Zèbres, comme la Villa Numeris, travaillent sur l’illectronisme, répondant en cela à l’une des préoccupations majeures remontées lors de notre étude auprès des élus à l’occasion de la préparation de Territoires et solutions.
P. I. —L’existence d’une association comme la vôtre témoigne d’une capacité à prendre en compte le risque social et à lui opposer des parades. Mais n’est-ce pas aussi le signe d’une certaine faillite des organismes publics ? Vous remplissez des missions que l’État pourrait prendre à sa charge…
C. L. R. — La nature a horreur du vide. Dans le cas présent, lorsqu’un domaine reste en friche, il n’est pas anormal qu’une association veuille s’en emparer et tâcher d’améliorer une situation sociale. Sur le rôle de l’État, en l’occurrence ses manques, restons mesurés : n’oublions pas qu’en matière de protection sociale la France présente un modèle assez remarquable. L’État ne peut pas s’immerger dans toutes les problématiques liées à la société. Les associations sont là aussi pour animer des mécanismes de solidarité et de complémentarité, jusqu’au dernier kilomètre.
P. I. — Diriez-vous que la jeunesse sait l’importance, aujourd’hui, de s’engager ? Et qu’elle prend des initiatives en ce sens ?
C. L. R. — Il existe un paradoxe : d’un côté, la génération montante se montre très soucieuse de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Si l’on se projette quelques décennies en arrière, le fossé est patent : à l’époque, les jeunes mordaient avec beaucoup plus d’avidité dans un métier et une carrière. Mais, d’un autre côté, la jeunesse actuelle est prompte à embrasser des causes, à s’engager dans telle ou telle association, à porter assistance avec un bel élan. Ce phénomène d’une population parfois exaltée est très appréciable. Il faut signaler au passage l’importance des réseaux sociaux : ils permettent d’attiser la curiosité envers des domaines vers lesquels la jeunesse n’irait pas spontanément.
P. I. — Un mot sur le nom de l’association. Il n’est pas commun…
C. L. R. — Le Zèbre est un roman bien connu d’Alexandre Jardin (1). Le nom de l’association est donc un discret hommage à l’auteur. Mais ce n’est pas tout : le zèbre est un animal fantasque, attachant, inattendu… et le zèbre est insensible à la piqure de la mouche tsé-tsé ! Notre plateforme ne renie pas ces qualificatifs. Quant à « bleu » et « blanc », cela renvoie bien sûr aux couleurs du drapeau. À notre manière, nous travaillons pour le pays, pour que les choses s’y déroulent plus harmonieusement.
P. I. — Votre initiative a jailli autour d’un événement politique. Ce qui ne vous empêche pas, depuis le début, de revendiquer un apolitisme total…
C. L. R. — C’est une règle d’airain. Ces derniers mois, la France a connu une actualité politique chargée ; à aucun moment, nous n’avons pris la parole. Nous dialoguons avec des élus de tous bords et nous savons bien qu’il s’agit de la clé de notre audience. Se montrer partisan irait à l’encontre de notre vocation première : être à l’affût du maximum d’initiatives déployées sur les territoires, pour informer ensuite le plus grand nombre d’acteurs et faire en sorte que ces initiatives infusent dans notre pays.
P. I. — Pour parler un peu crûment, Bleu Blanc Zèbre, en 2024, c’est combien de divisions ?
C. L. R. — Aujourd’hui, nous touchons plus de 3 millions de personnes, via un réseau d’environ 450 associations, qui emploient près de 4 000 salariés. Toutes ces associations sont labellisées Bleu Blanc Zèbre. Étant entendu que ce label ne s’obtient pas d’un claquement de doigts. Un comité de sélection a été créé pour examiner soigneusement les profils des dossiers. Trois critères, en particulier, permettent de se faire un avis raisonné. Nous sommes attentifs à la fois à l’aspect innovant de la démarche, à la pertinence du positionnement et au caractère duplicable de l’initiative. Car les associations sélectionnées par Bleu Blanc Zèbre n’ont pas vocation à se développer isolément : au contraire, nous attendons que leur mode de fonctionnement se révèle suffisamment inspirant pour donner à d’autres l’envie de marcher sur les mêmes traces.
P. I. — Diriez-vous que Bleu Blanc Zèbre est suffisamment connu auprès du grand public ?
C. L. R. — Nous ne sommes pas là pour être connus mais reconnus, pour notre utilité. Nous sommes là pour que les associations membres de la plateforme incarnent des valeurs, portent des projets et répandent de bonnes pratiques. Cette philosophie ne nous empêche pas de participer au débat public. Par exemple, nous avons été associés à l’Appel de Grigny, en 2021, quand des maires de banlieue ont lancé un Conseil national des solutions, avec la volonté de partager de nombreuses idées remontées du terrain. Nous avons contribué également au Plan Borloo (2). De même, nous échangeons régulièrement avec le Haut Conseil à la vie associative (HCVA) et plusieurs autres organismes dédiés au social. Mais il ne s’agit pas de communiquer à loisir sur ces contributions ou ces collaborations. Nous sommes là d’abord et avant tout pour labourer en profondeur.
P. I. — Nous l’avons rappelé en introduction : vous avez fêté vos dix ans. Quelles sont les perspectives de l’association pour la décennie à venir ?
C. L. R. — Nous avons une feuille de route. Celle-ci repose en priorité sur l’outil qu’est Territoires et solutions. Cette démarche nous permet de mailler le territoire. Année après année, nos événements favorisent l’ancrage dans un périmètre plus étendu. J’ai bon espoir que, d’ici quelques années, les valeurs de Bleu Blanc Zèbre auront essaimé quasiment partout. Certes, les menaces liées à l’abandon, au délaissement et au déclassement — cet éventail de risques qui ont provoqué l’émergence de Bleu Blanc Zèbre — n’auront pas disparu, mais il faut espérer que la société sera en mesure de mieux les affronter.
P. I. — L’un des risques qui menace la pérennité des associations est l’essoufflement. Comment entretenez-vous votre dynamique ?
C. L. R. — Personne n’est propriétaire de l’association. Nous avons le souci, notamment, que le président ne reste jamais trop longtemps en place, de sorte que des personnalités différentes puissent imprimer leur marque. Parallèlement, nos instances dirigeantes s’appuient sur un socle de compétences extrêmement solide. Avec des spécialistes reconnus dans chaque domaine, dont l’expertise est gage au quotidien d’une grande valeur ajoutée.
(1) Publié en 1988, Le Zèbre a été récompensé par le prix Femina. Le roman raconte la renaissance d’une passion amoureuse.
(2) Ce « Plan de réconciliation nationale » visait à « faire revenir la République » dans les quartiers.