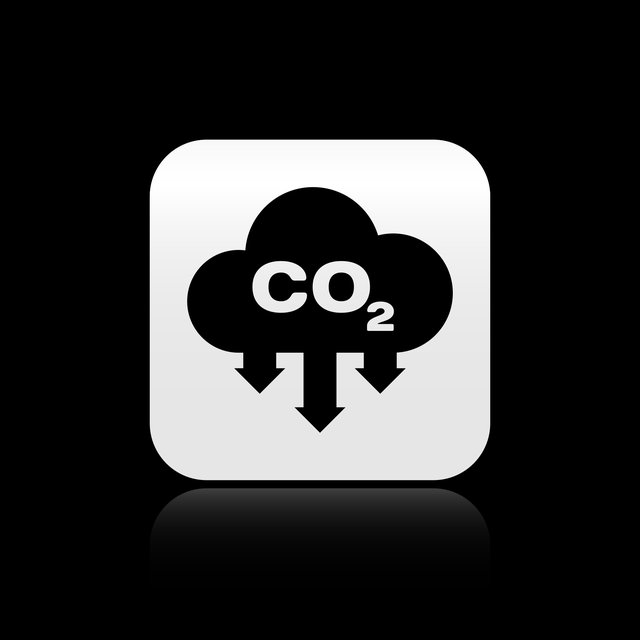
Politique Internationale — Quels sont les éléments qui permettent de juger de l’urgence climatique ? De quel recul historique dispose-t-on en la matière ?
Jean Jouzel — Il est effectivement utile de rappeler ce sur quoi on s’appuie. Nous avons désormais acquis la certitude que nos activités modifient la composition de l’atmosphère. Ainsi, à travers le transport, le logement, l’alimentation…, nous générons des gaz à effet de serre qui ont pour propriété de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu’il a été réfléchi à la surface de la Terre, ce qui a un impact sur notre climat. En termes de calendrier, il faut attendre le XIXe siècle pour voir les scientifiques se pencher sur le sujet. En 1896, le savant suédois Svante Arrhenius va plus loin ; il explique concrètement que l’utilisation du charbon, source de dioxyde de carbone CO2 (aussi appelé gaz carbonique), va conduire à un réchauffement significatif. S’agissant de sa concentration dans l’atmosphère, les premières analyses en continu n’ont commencé qu’en 1957. C’est donc relativement récent mais l’étude des glaces polaires a permis de reconstituer l’évolution de l’effet de serre sur les 800 000 dernières années, de montrer qu’il n’a jamais été aussi marqué que de nos jours et d’illustrer son lien avec les grands cycles climatiques. En remontant encore plus loin, on sait qu’il y a 50 millions d’années, période bien plus chaude que la nôtre, il y avait beaucoup plus de CO2 dans l’atmosphère. Aujourd’hui, la communauté scientifique se fonde sur une accumulation de données, enrichies en permanence. Certains de ces indicateurs, au demeurant, ne sont pas d’une justesse absolue. Prenons le cas de la Chine : en considérant les derniers chiffres, on s’aperçoit que la somme des émissions de CO2 de chaque province chinoise ne correspond pas exactement au total affiché pour l’ensemble du pays. L’écart est même assez notable…
P. I. — Qu’est-ce que cela signifie ? Que ces indicateurs sont manipulés ? Que les différents acteurs ne sont pas d’accord sur les statistiques ? Tout cela fait-il le jeu des climato-sceptiques ?
J. J. — Le fait que les pays ouvrent des négociations climatiques et prennent de grands engagements montre que des horizons ont été défrichés et que des balises chiffrées sont validées. Par exemple, un nombre croissant d’observateurs admet qu’une augmentation des températures de 4 à 5 °C d’ici la fin du siècle — si rien n’était fait pour lutter contre le réchauffement — serait catastrophique pour une large partie des populations. Cette perception des risques n’a pas toujours été aussi claire. La raison en est que l’on n’accorde pas suffisamment de crédit à la parole des experts. Comme les causes du réchauffement précèdent ses effets de quelques décennies, ces derniers ont du mal à convaincre de sa réalité avant qu’il ne soit effectif. Mais je ne me décourage pas pour autant : si nous les scientifiques commençons à dire que tout est perdu et que la lutte contre le réchauffement n’évoluera jamais favorablement, alors à quoi bon continuer à travailler ? Quant aux climato-sceptiques, quelle que soit la situation, ils seront toujours là. À l’automne dernier, quelque 500 « scientifiques » ont adressé une tribune à l’ONU pour proclamer l’absence de crise climatique. Disons que cela laisse un peu songeur…
P. I. — Pour refaire un point d’histoire, à partir de quel moment l’urgence climatique se fait-elle jour ?
J. J. — Jusqu’en 1950, à dire vrai, il ne se passe pas grand-chose. Le point de départ de l’urgence climatique correspond aux premiers travaux des modélisateurs du climat. Grâce à des calculateurs de plus en plus perfectionnés, des scénarios climatiques sont élaborés, qui intègrent les changements de composition de l’atmosphère. Au gré de ces études, l’inquiétude commence à pointer et on réalise de plus en plus que ces modifications ne sont pas neutres pour l’environnement. En 1979, le rapport Charney, du nom d’un climatologue américain, part sur l’hypothèse d’un réchauffement climatique compris entre 1,5 et 4,5 °C pour un doublement des quantités de CO2 dans l’atmosphère. Les années 1980 sont une période charnière pour les études climatiques : en 1987, les analyses réalisées sur le forage de Vostok en Antarctique illustrent le lien entre effet de serre et climat sur les 150 000 dernières années et mettent en lumière le fait qu’à cause de nos activités la concentration en CO2 n’a jamais été aussi élevée qu’aujourd’hui. À partir de cette époque, les scientifiques tirent vraiment la sonnette d’alarme et le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) se met en place en 1988. Nous n’avons plus cessé depuis d’alerter à travers nos rapports successifs en insistant sur les dangers de ce réchauffement lié à nos activités : pêle-mêle, l’acidification des océans, la fréquence accrue des extrêmes climatiques, le recul des précipitations dans certaines régions… Ces phénomènes ont une très forte incidence sur la vie quotidienne des populations : pourraient être menacés, dans certaines régions, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, la préservation des ressources en eaux, le respect de la biodiversité… Les gens mesurent désormais à quel point la disparition des récifs coralliens serait une catastrophe.
P. I. — Dans cette lutte contre le réchauffement climatique, a-t-on perdu du temps ? La situation actuelle vous rend-elle pessimiste, défaitiste, ou entrevoyez-vous des raisons d’espérer ?
J. J. — Ni pessimiste ni optimiste, simplement réaliste. En l’occurrence, on s’y est pris trop tard pour prendre le problème à bras-le-corps. Pourtant, le protocole de Kyoto acté en 1997, lui-même dans le prolongement de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptée en 1992 au sommet de la Terre à Rio, avait permis une prise de conscience des décideurs politiques. Si ce protocole, qui prévoyait une baisse de l’ordre de 5 % des émissions des pays développés, avait été respecté, une dynamique beaucoup plus vertueuse aurait été enclenchée. Cela étant, nous ne pouvions pas prévoir que les États-Unis, sous la mandature de George Bush, se montreraient tellement rétifs à cette politique climatique. Parallèlement, l’essor économique de la Chine a surpris par sa formidable intensité. Entre 2000 et 2010, le volume des émissions de CO2 de ce pays a plus que doublé. Cette pression supplémentaire sur l’atmosphère n’avait clairement pas été anticipée.
P. I. — L’énergie est considérée aujourd’hui comme le principal levier dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette appréciation est-elle, selon vous, justifiée ?
J. J. — Totalement. Sur les quelque 50 milliards de tonnes équivalent CO2 envoyées en 2018 dans l’atmosphère (ce chiffre tient compte des émissions de méthane, de protoxyde d’azote et autres gaz à effet de serre), environ 37 milliards, soit pas loin des trois quarts du total des émissions, sont le résultat de la consommation des énergies fossiles. Ce n’est pas une raison pour rejeter en bloc cette production : la croissance économique en est étroitement tributaire. C’est grâce aussi aux bienfaits de l’énergie que les gens vivent mieux à travers le monde. Ce n’est pas une raison non plus pour valider le modèle du « tout énergie » : un recours raisonné est absolument nécessaire pour tenir les objectifs de la COP21, à savoir la limitation à long terme des températures bien en-deçà de 2 °C — voire 1,5 °C — par rapport aux conditions préindustrielles. Et nous avons déjà pris 1 °C…
P. I. — Précisément, l’accord ratifié à Paris fin 2015 trouve-t-il une traduction opérationnelle sur le terrain ?
J. J. — D’abord et avant tout, c’est une excellente chose que d’avoir réussi à embarquer autant de pays autour d’un objectif environnemental ambitieux. Nous avons la preuve que la protection de l’environnement est un sujet partagé par tous, même s’il peut toujours y avoir un peu d’affichage politique. Cet accord de Paris est très intéressant mais il reste néanmoins une somme d’engagements volontaires. La démarche n’est pas contraignante et nous constatons aujourd’hui que plusieurs pays — y compris le nôtre — ont pris du retard par rapport à leur feuille de route. Certains autres se sont assigné des caps trop peu exigeants. Si l’on se réfère au but affiché de la COP21 — une limitation à 2 °C —, il va falloir, entre 2020 et 2030, faire trois plus d’efforts de réduction des émissions que prévu. Et si l’on veut limiter la hausse des températures à 1,5 °C, les engagements devront être multipliés par cinq sur cette même période. Il faut donc sérieusement rehausser l’ambition de cet accord de Paris à un moment où le retrait des États-Unis de Donald Trump le met en difficulté.
P. I. — Dans ce contexte, quel mix énergétique préconisez-vous ? Êtes-vous un partisan à tous crins des énergies renouvelables ? Comment voyez-vous évoluer la part du nucléaire ?
J. J. — J’ai, au titre du CESE, été co-rapporteur de la loi sur la transition énergétique (NDLR : votée en 2015). J’ai donc vu s’esquisser les orientations des pouvoirs publics et je dois dire que je suis assez favorable au scénario retenu, c’est-à-dire la montée en puissance des énergies renouvelables combinée à un repli mesuré du nucléaire, qui ne pèserait plus que 50 % dans la production d’électricité à l’horizon de 2035 contre 75 % actuellement. Au passage, trop de personnes pensent électricité à la place d’énergie : ils oublient que la mobilité et la production de chaleur sont deux foyers très importants de consommation qui font encore la part belle aux combustibles fossiles, premiers contributeurs à notre mix énergétique. Le nucléaire et les renouvelables ont, en régime de fonctionnement, l’avantage de ne pas émettre de CO2. À l’échelle de la planète, le nucléaire fournit environ 5 % des besoins en énergie primaire et il n’est pas sérieusement envisagé que cette part excède 10 % d’ici à 2050. Les énergies renouvelables représentent un gisement considérable, avec un énorme potentiel à valoriser. À la condition bien sûr que des investissements suffisants puissent y être affectés. On entend souvent parler des milliards requis par la construction d’une nouvelle centrale nucléaire, mais l’édification de capacités de renouvelables nécessite également un très gros effort financier. Quoi qu’il en soit, une politique énergétique efficiente ne se borne pas à la recherche d’un équilibre entre les moyens de production. Elle implique aussi une meilleure efficacité énergétique avec, ce sera indispensable, une réelle sobriété à tous les niveaux.
P. I. — Sur le papier, la France promeut largement les énergies vertes mais, sur le terrain, les projets mettent longtemps à se réaliser…
J. J. — C’est un vrai problème et, dans ce cas précis, les oppositions aux énergies renouvelables atteignent un stade exagéré. Je suis évidemment pour le respect de la loi, mais force est de reconnaître qu’au regard de l’application des textes actuels les recours multiples contribuent littéralement au gel des projets verts. En Allemagne, le projet d’un parc éolien ou solaire pourra aboutir en cinq à sept ans. En France, certains dossiers sont tellement controversés qu’ils peuvent rester dans les cartons pendant plus de dix ans. L’exemple de l’éolien offshore est révélateur : alors que les premiers parcs ont été attribués en 2012, aucun chantier n’a encore vraiment démarré. La transition écologique a certes besoin de règles — j’y suis attaché — mais aussi de simplification : sinon, on repasse dans dix ou quinze ans et rien n’aura bougé.
P. I. — Personne n’a oublié en France la crise des Gilets jaunes, qui a été perçue comme la réponse à une fiscalité écologique jugée punitive. Dans votre ouvrage Pour éviter le chaos climatique et financier, co-écrit avec l’économiste Pierre Larrouturou, vous tentez de montrer que la lutte contre le réchauffement peut dynamiser l’économie. À la lumière des événements récents, défendez-vous toujours cette thèse ?
J. J. — Je suis persuadé que la transition écologique se traduira par un gain pour l’économie. Les pays qui les premiers auront adopté cette démarche seront les premiers à en profiter. À quel horizon ces bénéfices se feront-ils sentir ? Il faut rester prudent, mais une fourchette de dix à vingt ans me paraît plausible. La conjoncture actuelle est difficile parce que les gens ont le sentiment — et ils n’ont pas tort — que cette phase de transition commence par détruire des emplois. Par exemple, la fermeture d’une centrale à charbon a mécaniquement une incidence sur le tissu économique et social. Mais la construction de nouveaux moyens de production renouvelables, le développement de l’efficacité énergétique, le réaménagement d’une ville ou encore l’optimisation des infrastructures de transport sont des chantiers qui créent de l’emploi. Dès lors que la transition entre une économie largement fossilisée et une économie plus respectueuse de l’environnement sera sur les rails, l’impact de la lutte contre le réchauffement se révélera très positif.
P. I. — Et pour la fiscalité écologique…
J. J. — L’augmentation de la taxe carbone est très mal tombée. Cet épisode a au moins permis de constater deux choses : la première, c’est que la fiscalité écologique doit être juste. Et la seconde, c’est qu’elle doit déboucher sur des compensations, notamment pour les personnes dont le pouvoir d’achat est le plus impacté. Autant dire que le politique a un rôle essentiel à jouer. En 2009, nous avions contribué à la rédaction du rapport de Michel Rocard sur la taxe carbone : celui-ci avait fait des propositions équilibrées qui malheureusement ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Si elles avaient été entérinées, elles auraient favorisé un atterrissage en douceur de ce dossier. Des mesures justes et des compensations donc, mais ce n’est pas tout : il faut aussi de la transparence, donner l’assurance au consommateur que les taxes dont il s’acquitte bénéficient réellement à l’environnement. Or Bercy est un peu une boîte noire : il n’y a pas ou peu de fléchage qui permette de tracer la fiscalité écologique.
P. I. — Que pensez-vous de Greta Thunberg, qui fait figure d’égérie pour la jeunesse ?
J. J. — Je suis favorable à ce genre d’interventions. Le débat climatique ne doit pas être confisqué par telle ou telle corporation. C’est bien que les franges les plus étendues de la société puissent s’exprimer. On parle de Greta Thunberg, mais il faut insister aussi sur la mobilisation des associations. Les élus territoriaux devraient être encore plus mis en avant : ils sont au contact direct des populations et savent précisément comment les programmes de protection de l’environnement peuvent s’appliquer. La pédagogie climatique passe également par eux : cet effort de sensibilisation, Greta Thunberg l’accomplit depuis le début. Comment ne pas souscrire à un discours qui appelle la jeunesse à faire confiance aux scientifiques ? En France, le ministère de l’Éducation, qui n’est pas resté sourd à la mobilisation des jeunes et aux recommandations des climatologues, a demandé au Conseil supérieur des programmes (CSP) d’assurer un meilleur apprentissage — à l’école, au collège et au lycée — du débat environnemental. Je me félicite de cette initiative.













