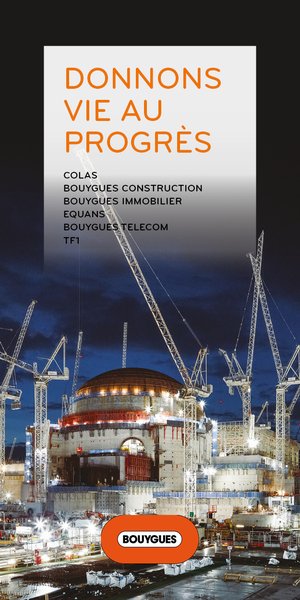Le 27 septembre 2020, la région du Haut-Karabagh s’est embrasée une nouvelle fois, quand l’Azerbaïdjan a lancé une vaste offensive contre cette enclave qui lui appartient de jure mais qui était, de facto, contrôlée par l’Arménie voisine et peuplée presque exclusivement d’Arméniens (150 000 habitants selon un recensement effectué en 2015).
Pour comprendre ce conflit — l’un des nombreux conflits gelés que l’on retrouve sur le territoire de l’ancienne Union soviétique —, il faut revenir loin en arrière. La région, appelée Artsakh en arménien, constitue l’une des provinces de l’Arménie historique, ce petit pays du Caucase du Sud à l’histoire millénaire, le premier du monde à avoir adopté, en 301, le christianisme comme religion d’État. La position géographique de l’Arménie, à la croisée de l’Orient et de l’Occident, lui vaut de subir dominations et influences successives — Grecs, Romains, Parthes, Perses, Mongols… Néanmoins, le montagneux Karabagh conserve, durant toutes ces périodes, une population majoritairement arménienne. Au début du XIXe siècle, l’Empire russe s’empare de l’ensemble du Caucase, y compris l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
En 1918, à la faveur de l’effondrement du tsarisme, l’Arménie et l’Azerbaïdjan proclament leur indépendance. Les deux voisins se livrent immédiatement une violente guerre qui s’accompagne de nettoyages ethniques de part et d’autre. Le Haut-Karabagh, mais aussi Bakou et d’autres territoires, font l’objet de luttes féroces entre les Arméniens et les Azéris. En 1920, avec l’avancée de l’Armée rouge dans le Caucase, c’en est fini de l’indépendance de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, qui sont tous deux intégrés à l’URSS. En 1921, Joseph Staline, alors commissaire aux nationalités de l’Union soviétique, décide de rattacher la région du Haut-Karabagh, peuplée d’Arméniens, à la République socialiste soviétique (RSS) d’Azerbaïdjan. Ce faisant, il cherche à « diviser pour mieux régner », mais aussi à donner un gage d’amitié à l’Azerbaïdjan, une république riche en pétrole, et à la Turquie kémaliste, traditionnellement protectrice des Azerbaïdjanais, un peuple turcique musulman.
Pendant l’époque soviétique, le Haut-Karabagh bénéficiera du statut de république autonome au sein de la RSS d’Azerbaïdjan et sa population demeurera majoritairement arménienne. Pendant près de sept décennies, l’hostilité arméno-azerbaïdjanaise est mise sous l’éteignoir. Mais la fragilisation puis la dissolution de l’URSS font resurgir la vieille querelle.
En 1988, lorsque de nombreux territoires de l’Union entament leur marche vers l’indépendance, la population du Haut-Karabagh demande son rattachement à l’Arménie. Cette demande est rejetée par Mikhaïl Gorbatchev et par les autorités de Bakou. La situation se dégrade rapidement. Des violences interethniques éclatent et dégénèrent en une guerre ouverte entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui proclament par ailleurs tous deux leur indépendance vis-à-vis de l’URSS finissante à l’automne 1991… de même que le Haut-Karabagh. Le conflit dure six ans : il fera près de 30 000 morts. Le cessez-le-feu conclu en 1994 est à l’avantage de l’Arménie. Le Haut-Karabagh annexe sept districts azerbaïdjanais frontaliers et obtient une indépendance de fait, même si celle-ci n’est pas reconnue par la communauté internationale. Bakou n’a plus aucune influence sur la vie de la petite région. Depuis, la ligne de front est restée figée, avec des flambées de violence ponctuelles. Avant de se rallumer brutalement, en septembre 2020…
Si ce nouvel embrasement a surpris par sa violence, plusieurs observateurs avaient relevé, dans les mois précédant la reprise du conflit, des signes d’une montée des tensions. Selon l’ambassadeur pour le Partenariat oriental de l’Union européenne et de la mer Noire, Stéphane Visconti, les négociations entre Bakou et Erevan, entamées depuis 1994 sous l’égide du groupe de Minsk (une instance regroupant une quinzaine de pays et coprésidée par la France, les États-Unis et la Russie) avaient été quasiment paralysées. Les deux acteurs, explique-t-il, « campaient sur des positions qui ont rarement été aussi maximalistes, chacun considérant que le temps joue pour lui et renforce ses cartes ».
Un autre déclencheur du conflit souvent évoqué est la crise économique interne à l’Azerbaïdjan, liée à la baisse des prix du pétrole, dont Bakou, qui dispose des vingtièmes réserves mondiales, est un grand exportateur. Des décennies durant, la manne pétrolière a aidé le régime autoritaire et clanique des Aliev (Ilham Aliev, l’actuel président, a succédé à son père Gueïdar Aliev en 2003, à la mort de celui-ci) à se maintenir en place. La mobilisation patriotique autour du thème fédérateur de la récupération du Haut-Karabagh a été, selon de nombreux analystes, vue par les autorités de Bakou comme un moyen de canaliser le mécontentement croissant de la population.
Enfin, il semble évident que la Turquie de Recep Tayyip Erdogan a joué un rôle important dans la relance de la guerre. En effet, dès le lendemain de l’attaque azerbaïdjanaise du 27 septembre, Ankara se dit prête à soutenir Bakou « par tous les moyens ». Les Turcs, ne voulant plus laisser le règlement du conflit arméno-azerbaïdjanais au groupe de Minsk, dont ils ne font pas partie, ont manifestement décidé de souffler sur les braises pour s’imposer, de force, à la table des négociations et, plus globalement, pour mettre un pied dans cette région, le Caucase, où jusqu’à présent la prédominance de la Russie était incontestée. En outre, Erevan est une ennemie de longue date d’Ankara qui refuse de reconnaître la réalité du génocide perpétré par les Turcs contre les Arméniens en 1915. Nourries par la Turquie, l’hostilité et l’intransigeance sont devenues telles que tout dialogue a été rendu impossible (1). L’Azerbaïdjan a donc préféré faire parler les armes plutôt que les diplomates. D’autant que, contrairement à la guerre d’il y a trente ans, sa supériorité militaire a, cette fois-ci, été incontestable…
En effet, grâce aux revenus du pétrole, l’Azerbaïdjan a considérablement investi dans son appareil de défense, notamment dans les drones et les munitions rôdeuses (2) ou « drones suicides » (livrés en quantité par Israël (3)) qui vont montrer toute leur efficacité lors de ce conflit. Par surcroît, l’Azerbaïdjan aurait bénéficié du soutien de plusieurs centaines de mercenaires syriens et libyens recrutés par la Turquie (aussi bien Ankara que Bakou ont démenti leur présence, mais celle-ci est confirmée par de nombreux témoins sur place (4)).
Face à l’alliance entre l’Azerbaïdjan, trois fois plus peuplé que sa petite voisine, et la grande Turquie, l’armée du Karabagh, appuyée par les troupes arméniennes, ne peut pas tenir longtemps. Officiellement, on dénombre 4 005 morts, plus de 1 500 disparus et près de 11 000 blessés et invalides du côté arménien, mais certaines sources donnent des chiffres encore plus élevés. Le bilan est également lourd côté azéri, avec 2 895 morts. Enfin, 541 mercenaires syriens auraient également péri lors des combats (selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme) (5). Acculé, cédant toujours plus de terrain à son adversaire, le gouvernement arménien est contraint de jeter l’éponge au bout de 44 jours d’affrontements. Le cessez-le-feu, conclu avec la médiation de Moscou, est annoncé dans la nuit du 10 novembre.
« Mes chers compatriotes, sœurs et frères, j’ai pris pour moi et pour nous tous une décision lourde, incroyablement douloureuse. Je viens de signer avec les présidents de la Russie et de l’Azerbaïdjan une déclaration mettant fin à la guerre du Karabagh. Je ne peux pas dire à quel point son contenu est douloureux, pour moi et pour notre peuple », annonce le premier ministre arménien Nikol Pachinian. L’accord de paix est en effet un énorme revers pour l’Arménie. Le texte prévoit la restitution à l’Azerbaïdjan des sept districts occupés jusqu’ici par le Karabagh au titre du « périmètre de sécurité » et le déploiement pour une durée de cinq ans de forces de maintien de la paix, sous l’égide de la Fédération de Russie, sur la ligne de contact du Haut-Karabagh et le long du corridor de Latchine (le corridor stratégique qui relie le territoire du Haut-Karabagh à celui de l’Arménie). Surtout, le Karabagh perd la ville de Chouchi (Choucha en azéri), sa deuxième ville après la capitale Stepanakert. Si, avant le conflit, le Karabagh comptait, avec les sept districts occupés, 11 458 km2, il ne lui reste, dans les frontières tracées par l’accord de 2020, que 3 170 km2 ! Comble de l’humiliation, l’épineuse question du statut de la république autoproclamée ne figure pas dans l’accord…
L’annonce provoque une onde de choc : la population arménienne (qui a, depuis le début du conflit, entendu des discours patriotiques et rassurants) peine à avaler cette déroute. Le 10 novembre, des milliers de protestataires envahissent le centre d’Erevan. Défaite, humiliation, tant de jeunes vies perdues ou brisées… pour rien. Nikol Pachinian et son gouvernement subissent des critiques violentes, les manifestants s’introduisent dans le palais du gouvernement, la résidence de Pachinian est saccagée.
Dans les mois suivants, la crise politique interne va s’aggraver. Le 25 avril, Nikol Pachinian annonce sa démission (il continue toutefois d’exercer ses fonctions par intérim) et la tenue d’élections législatives anticipées le 20 juin 2021.
Élu en 2018 à la suite d’une « révolution de velours » (6), Nikol Pachinian avait amené avec lui une nouvelle génération de dirigeants issus de la société civile et prônant un rapprochement avec l’Occident.
D’après plusieurs observateurs, par cette adhésion affichée aux valeurs occidentales et une certaine prise de distance vis-à-vis de Moscou, Pachinian avait quelque peu refroidi les relations avec ce grand allié et protecteur de l’Arménie. Néanmoins, c’est Vladimir Poutine que Pachinian et le président du Haut-Karabagh Araïk Haroutunian appellent au secours à plusieurs reprises au cours du conflit. En vain. La Russie, alliée de l’Arménie dans le cadre du traité OTSC (7), argue que le conflit ne se déroule pas sur le territoire de l’Arménie proprement dite (la République du Haut-Karabagh, ou Artsakh, n’est pas reconnue comme un État indépendant ni par la Russie ni même par l’Arménie). Moscou ne veut pas se départir de son statut de médiateur et se mettre à dos l’Azerbaïdjan et la Turquie. Le Kremlin est certes contrarié par l’immixtion d’Erdogan dans le Caucase mais il comprend qu’il ne peut pas l’empêcher. Gérer et contenir les ambitions néo-ottomanes d’Erdogan plutôt que s’y opposer frontalement : telle est la stratégie choisie par le président russe aussi bien dans le Caucase que, précédemment, en Syrie ou en Libye, où Ankara poursuit son expansion militaire et diplomatique.
Le cessez-le-feu du 10 novembre 2020 est présenté comme une grande victoire pour la Russie qui s’impose comme force d’interposition entre Arméniens et Azéris. Près de 2 000 soldats russes sont immédiatement déployés dans la région. Même si la Russie a pu contenir les visées turques, c’est aussi une grande avancée pour la Turquie ; elle a négocié l’envoi d’un contingent militaire au Centre d’observation du cessez-le-feu — autrement dit, elle a réussi à mettre un pied au Caucase.
Cette amère défaite a plongé l’Arménie dans une crise politique et a produit, au Haut-Karabagh, le deuil et la dévastation. Le territoire doit se reconstruire, panser ses plaies, faire revenir ses habitants (déjà assez peu nombreux) qui, pour certains, ont tout perdu et tenter de remettre à l’ordre du jour international la question de son statut. Alors que le président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliev a déclaré que cette question « ne se posait plus », les habitants du Karabagh refusent l’idée de vivre au sein de l’Azerbaïdjan. Comme par le passé, l’Azerbaïdjan invoque le principe d’intégrité territoriale tandis que l’Arménie et le Karabagh en appellent à l’autodétermination des peuples. Tant que ces principes seront mis sur un pied d’égalité, on aura du mal à entrevoir une issue…
Pour discuter de toutes ces questions sensibles et de la situation sur le terrain, Politique Internationale s’est entretenue avec le président du Haut-Karabagh, Araïk Haroutunian. Originaire de Stepanakert, il a occupé le poste de premier ministre de la république autoproclamée de 2007 à 2017. En 2017, le Haut-Karabagh adopte une nouvelle Constitution qui établit un régime présidentiel. Le 31 mars 2020, Haroutunian arrive en tête lors du premier tour de l’élection présidentielle avec 49,17 % des voix. Il est élu au second tour le 14 avril suivant avec 88 % des voix. Pendant le conflit, il a pris les armes et est allé rejoindre les combattants sur la ligne de front. Sans pouvoir empêcher la débâcle.
N. R.
$Natalia Routkevitch — Quelques mois après le conflit sanglant de l’automne dernier, quelle est la situation au Haut-Karabagh ? La paix est-elle totalement restaurée ? La vie a-t-elle repris ses droits ? Les habitants sont-ils revenus ? Les institutions de l’État fonctionnent-elles ?
Araïk Haroutunian — Je tiens d’abord à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à notre région. Tout regard extérieur sur notre petit pays et le peuple qui y vit est important pour nous. Car nos ennemis, l’Azerbaïdjan et la Turquie, ont tendance à déformer la réalité, ce qui dénature profondément les processus qui s’y déroulent.
Pour répondre à vos questions, je dois dire que la situation est relativement stable. Il est très difficile de faire revenir la vie à son cours normal dans un pays qui a supporté le poids d’une telle guerre, mais le gouvernement y travaille au quotidien. Presque toutes les infrastructures, qui avaient été détruites ou mises hors service dans leur quasi-totalité, sont déjà rétablies. Beaucoup sont agréablement surpris de constater que nous y soyons parvenus en si peu de temps. Mais, hélas, les pertes humaines et territoriales sont telles que ces questions sont devenues secondaires. Les institutions et l’administration de l’État, dont la charge est immense, fonctionnent pleinement et vont même au-delà du cadre strict de leurs compétences.
Nous sommes conscients que l’essentiel est de surmonter le traumatisme d’après-guerre, de retrouver un état d’esprit serein afin que les gens non seulement reviennent en Artsakh mais y vivent et aient envie d’y construire leur avenir. Aujourd’hui, plus de 70 % de la population est revenue. Et lorsque nous réussirons à donner un toit à tous ceux qui n’en ont plus, je pense que nous aurons un taux de réinstallation plus important encore. Il faut savoir que près de 27 % des habitants de l’Artsakh ont perdu leur foyer à la suite de l’occupation par l’Azerbaïdjan de nos territoires. J’ajoute que le retour des Artsakhiotes dans ces territoires n’est pas envisageable tant que ceux-ci restent sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, car tout Arménien qui oserait s’y aventurer risquerait d’être aussitôt exécuté.
N. R. — Quel regard portez-vous sur l’action des forces russes de maintien de la paix ? Comment leur présence est-elle perçue dans la république ?
A. H. — Leur présence (on parle d’environ deux mille soldats) est perçue comme très positive. Les relations entre les forces russes et la population artsakhiote sont excellentes. Nos citoyens sont parfaitement conscients de l’importance de leur mission. Ils y voient une véritable garantie de sécurité face à des forces ennemies qui occupent une partie du territoire de leur État.
N. R. — En règle générale, les Arméniens éprouvent-ils un sentiment de trahison ou de déception à l’égard de la Russie, dont ils espéraient un meilleur soutien pendant le conflit ?
A. H. — Nous sommes reconnaissants à la Fédération de Russie, l’un des pays coprésidents du groupe de Minsk, qui a été la seule à prendre des mesures concrètes pour arrêter l’effusion de sang et pour établir une paix stable. Permettez-moi d’ajouter que cette intervention russe …
Ce site est en accès libre. Pour lire la suite, il vous suffit de vous inscrire.
J'ai déjà un compte
M'inscrire
Celui-ci sera votre espace privilégié où vous pourrez consulter à tout moment :
- Historiques de commandes
- Liens vers les revues, articles ou entretiens achetés
- Informations personnelles